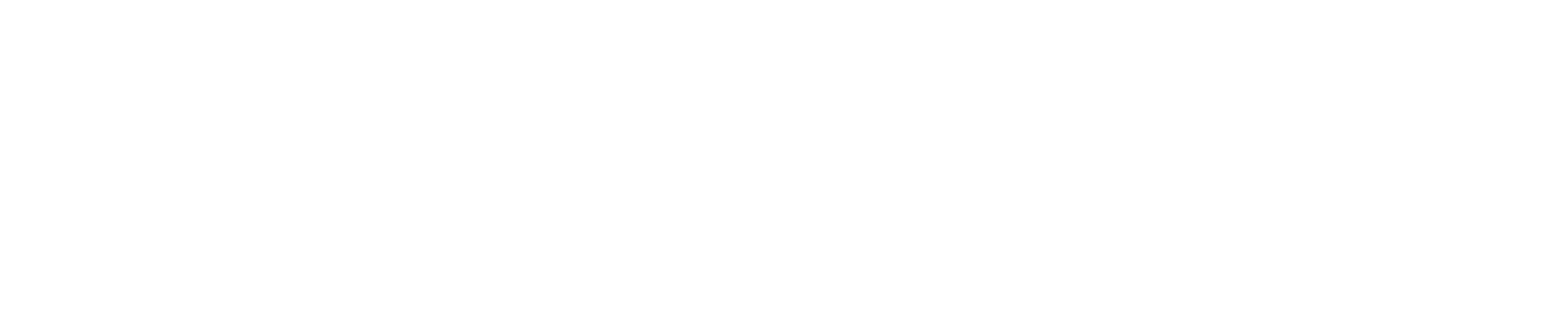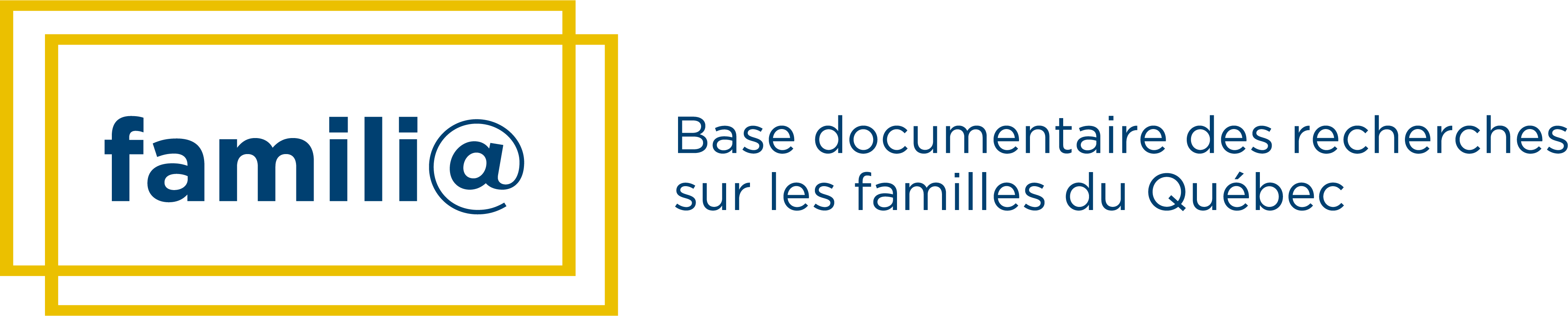Perdre un enfant pendant la grossesse ou à la naissance est bouleversant et douloureux. Pour les familles touchées, le deuil invisible d’un être, souvent silencieux, représente une lourde épreuve venant particulièrement ébranler l’équilibre émotionnel et conjugal. Durant la pandémie, les mesures sanitaires et l’isolement ont fragilisé les mécanismes de soutien habituels, notamment l’offre de services et les soins offerts aux parents. Quels impacts ce contexte a-t-il eu sur les parents confrontés à un deuil périnatal?
Afin d’analyser en profondeur comment la COVID-19 a transformé l’expérience des parents vivant un décès périnatal, une équipe de recherche de l’Université du Québec en Outaouais a mis au point une étude auprès de 58 femmes vivant au Québec, ayant perdu un enfant entre la 6ᵉ et la 40ᵉ semaine de grossesse. Leurs objectifs? Mieux comprendre leur réalité et proposer des recommandations pour améliorer l’accompagnement des parents endeuillés dans ces moments difficiles.
Perte d’un enfant et restrictions sanitaires : la double épreuve des parents endeuillés
En matière de deuil périnatal, il y a définitivement eu un avant et un après la pandémie. Auparavant, lors de la perte d’un nouveau-né, les services de maternité offraient aux parents une trajectoire de soins structurée et personnalisée. Suivi médical régulier, accompagnement lors de l’annonce du décès, soutien psychologique post-deuil incluant des rituels de commémoration et des groupes de soutien : tout était mis en place pour soulager du mieux possible la douleur de la perte, sur le plan physique et mental. Avec la pandémie et les bouleversements qu’elle a engendrés, cette prise en charge des plus complètes s’est retrouvé tronquée et variable. En conséquence? Des précédents majeurs sur la santé psychologique des parents endeuillés. En plein cœur de la crise, les mesures sanitaires rendaient impossible la présence des parents auprès de leur bébé décédé, un moment clé pourtant essentiel dans le processus de deuil. Sans compter que dans certains établissements, un seul parent était autorisé à être présent au chevet de l’enfant; le deuxième a donc été empêché de voir ou de prendre son bébé vivant avant son décès. Cette restriction obligatoire a contribué à un sentiment d’injustice et de souffrance psychologique à long terme.
« Le fait que mon conjoint et moi ne pouvions visiter notre bébé ensemble quand il était encore en vie et que seul un des deux pouvait y aller a fait en sorte que je n’ai pu toucher et voir mon bébé vivant avant son décès. »
– Une mère participant à l’étude
Pères en marge des services de périnatalité
Entre bienvenus et exclus, les services de périnatalité n’ont pas toujours accueilli à bras ouverts l’implication des papas au moment de l’accouchement. La pandémie a exacerbé cette tendance par leur exclusion systématique du parcours médical et du processus de deuil. Interdiction d’assister aux échographies, aux consultations médicales et, dans certains cas, à l’accouchement : les pères ont été relégués au rôle de spectateur. Quant aux mères, elles ont été obligées d’affronter seules l’annonce de la perte de leur enfant.
Bon nombre d’entre elles soulignent la difficulté persistante d’intégrer leur conjoint dans les services périnataux, que des mesures sanitaires soient en place ou non. Elles font notamment état de la place restreinte qui leur est accordée dans l’expérience de la grossesse, de la parentalité et du deuil. En négligeant leur vécu et leurs besoins, l’idée selon laquelle le rôle des papas se limite à la conception est renforcée; tout comme le stéréotype qui les réduit à de simples géniteurs plutôt qu’à des parents pleinement engagés.
Le réseau de soutien : absent pendant et après
Les conséquences de cette prise en charge perturbée ne se sont pas fait ressentir uniquement durant le séjour en périnatalité. Des impacts durables sur la santé mentale des mères ont éclos après leur sortie. En effet, le manque de suivi psychologique, le soutien réduit et l’isolement social ont conduit de nombreuses femmes interrogées à développer des symptômes de deuil prolongé ou compliqué. Ainsi, alors que plus de la moitié rapporte un niveau élevé de deuil, une majorité déclare ressentir une solitude émotionnelle importante.
Plusieurs manifestations confirment que la crise sanitaire a aggravé les troubles psychologiques liés au deuil périnatal chez de nombreuses mères, au point de leur laisser de profondes séquelles. L’étude rapporte entre autres que ces difficultés ne sont toujours résolues aujourd’hui. La pandémie a entraîné une diminution du soutien offert aux parents avant et après un décès périnatal. Comme soulevé par une personne de l’équipe de recherche, cela soulève des inquiétudes quant aux effets à long terme de cette expérience sur les grossesses et les accouchements futurs.
La face cachée des protocoles sanitaires? Un suivi périnatal compromis
L’autre constat majeurs de cette étude? L’inégalité dans l’application des mesures sanitaires d’un établissement à l’autre. Certaines institutions ont imposé des restrictions plus sévères que d’autres, compliquant encore davantage l’accès aux soins. Les consultations médicales par exemple, ont souvent été limitées aux suivis téléphoniques. Bien que nécessaires dans le contexte de la crise sanitaire, ces procédures ont pu empêcher la détection précoce de complications.
« J’avais seulement des suivis au téléphone, alors difficile de savoir si quelque chose ne va pas. J’ai appris toute seule dans le bureau du médecin que le cœur ne battait plus. Je n’avais pas le droit d’être accompagnée par mon conjoint. J’ai dû me rendre seule à l’hôpital pour faire une échographie […]. J’ai appris toute seule, dans son bureau, avec le masque au visage, que ma fille était décédée […]. Ce moment me hante, j’y repense sans cesse. »
– Une mère participant à l’étude
Cette prise en charge lacunaire a accentué les risques de stress post-traumatique et d’anxiété. Comme en témoignent les participantes, à la suite de leur expérience, près de neuf femmes sur dix présentent des niveaux d’anxiété et de dépression jugé sérieux par les professionnel·le·s de la santé et préoccupant sur le plan médical.
Un besoin urgent de revoir les protocoles de soins périnataux
Alors que la plupart des mesures sanitaires sont levées depuis quelques années, certaines pratiques de prise en charge adoptées pendant la pandémie sont toujours d’actualité. De ce fait, revoir la trajectoire de soins afin de garantir une prise en charge complète et bienveillante, ainsi qu’un accompagnement structuré et adapté aux besoins des parents endeuillés est essentiel. Pour y parvenir, les professionnel·le·s de la santé gagneraient à reconnaître l’ampleur des conséquences psychologiques du décès périnatal, à détecter la détresse parentale et à offrir un soutien empathique et personnalisé, notamment par l’entremise de formations adéquates. Une attention particulière devrait également être portée à l’inclusion des pères dans le parcours de soins et le processus de deuil. Leur présence leur permettrait de partager ces moments clés avec leur conjoint·e et leur enfant, et de sensibiliser les équipes médicales à leur rôle parental, souvent minimisé, voire oublié.
Par ailleurs, bonifier les services offerts après un décès en rendant accessible un soutien psychologique à long terme pour les deux parents – quel que soit le stade de la grossesse au moment du décès – s’avère salutaire à bien des égards. Un tel accompagnement dans les mois et années suivant la perte permettrait de limiter les risques de deuil prolongé et de troubles psychologiques sévères. Enfin, la recherche souligne l’importance de mener des études à long terme pour mieux comprendre l’impact du décès périnatal sur la santé mentale des parents dans le temps et son influence sur leur trajectoire parentale. Évaluer les interventions existantes et développer des pratiques cliniques adaptées qui tiennent compte de la complexité des expériences vécues par ces familles, notamment en cas de procréation assistée ou de fausses couches répétées, ferait une réelle différence.