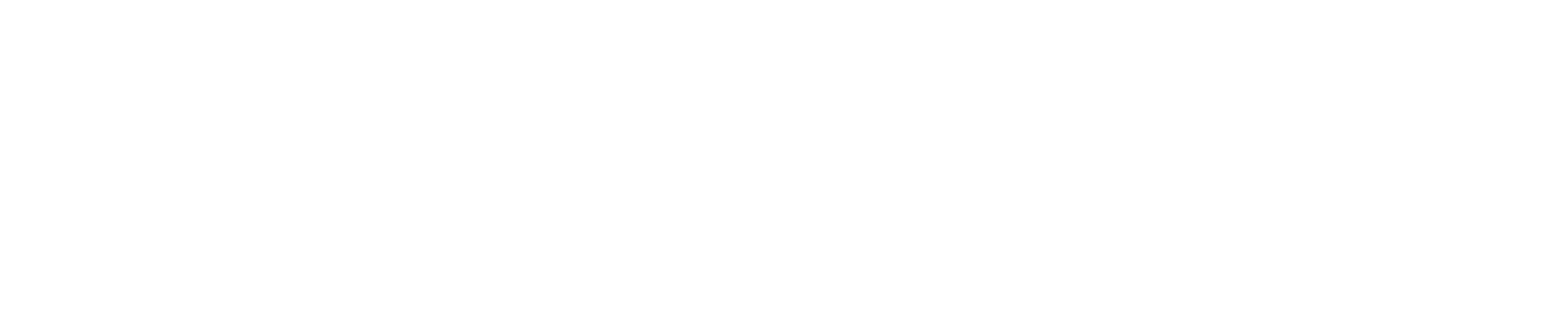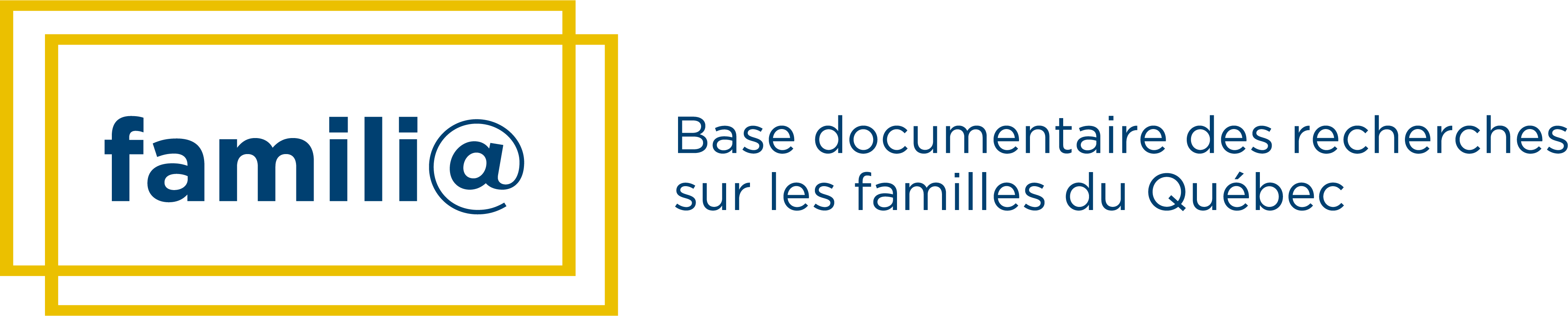52 808. Il s’agit du nombre de personnes immigrantes admises au Québec en 2023. Parmi elles, près de 7 personnes sur 10 appartiennent à la catégorie de l’immigration économique1 et sont communément décrites comme des personnes immigrantes hautement qualifiées. Les sujets incontournables quand vient le temps de se pencher sur leur réalité sont la recherche d’emplois ou la non-reconnaissance des diplômes. Pourtant, l’immigration des personnes hautement qualifiées dépasse largement la question du parcours professionnel. Cette transition chamboule non seulement la vie des nouveaux et nouvelles arrivant·e·s, mais aussi, lorsque l’immigration se fait en couple, les rôles des partenaires et la gestion de la vie commune.
Anna Goudet, doctorante en études urbaines à l’Institut national de la recherche scientifique et à l’Université du Québec à Montréal, s’interroge sur la gestion de l’argent et sur les décisions résidentielles des couples hétérosexuels immigrants hautement qualifiés de la période prémigratoire à l’établissement au Canada. Au total, la chercheuse s’intéresse au vécu des deux partenaires de 8 couples et d’un·e des deux partenaires de 9 couples. Elle trace ainsi un portrait de 17 situations conjugales.
Parmi ces couples provenant de neuf pays différents (Algérie, Burkina Faso, Colombie, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, France, Mexique et Roumanie), les conjoint·e·s possèdent tous et toutes un diplôme postsecondaire et presque la totalité travaillait à temps plein avant l’immigration (sauf deux conjointes qui étaient aux études). Dix-huit s’identifient à un groupe racisé. Une fois au Canada, certaines personnes travaillent dans le même domaine professionnel, mais la majorité est surqualifiée et s’est réorientée. Malgré tout, la moyenne des revenus familiaux de ces couples se situe au-dessus de celle des familles immigrantes du Québec.
Trois manières bien différentes de vivre sa vie conjugale
Le premier constat de la chercheuse? Trois manières de vivre sa vie conjugale ressortent chez les couples immigrants hautement qualifiés : le projet conjugal, la complémentarité conjugale et la mutualité conjugale. Pour chacune, les conditions initiales du couple, l’adaptation aux épreuves migratoires et la redéfinition des priorités ont été analysées.
Le projet conjugal regroupant la majorité des couples (9) se caractérise par des prises de décision à deux et par une mise en commun financière, et ce très tôt dans leur relation. Ils se démarquent également par un plus grand nombre de ressources prémigratoires, dont financières, et sont moins victimes de discriminations raciales. À l’inverse, ceux dont la dynamique est qualifiée de complémentarité conjugale (5) adhèrent au modèle du pourvoyeur masculin exclusif comme idéal conjugal, possèdent peu de ressources prémigratoires et expriment de plus grandes difficultés en raison du racisme vécu. Pour s’adapter aux pertes engendrées par l’immigration, leur idéal conjugal est remplacé par le partage des dépenses entre les conjoint·e·s. Finalement, la mutualité conjugale représentant 3 couples se caractérise par une gestion de l’argent équitable, une autonomie individuelle et un processus décisionnel en commun. Chez ces couples, les ressources prémigratoires sont limitées et les discriminations sur le marché de l’emploi et du logement demeurent un enjeu.
« L’union fait la force », mais à quel prix?
Être une équipe pour traverser les épreuves que présente l’immigration, une bonne stratégie pour les couples? Oui, mais ils n’échappent pas pour autant aux inégalités qui s’incrustent peu à peu dans la vie conjugale. En effet, pendant que les conjointes voient leur contribution financière s’effacer par la mise en commun des dépenses, celle de leurs conjoints, bien que moindre, est plutôt visibilisée. Ce constat est davantage observé chez les couples dont la dynamique est le « projet conjugal ». Par exemple, la conjointe d‘un couple ayant deux enfants et originaire de Colombie souligne que le salaire de son conjoint payé en argent comptant est déposé « dans un pot de beurre de peanut » à la vue de tous et toutes et est utilisé pour payer les dépenses quotidiennes ou les projets familiaux spéciaux. À l’inverse, son salaire couvre les dépenses familiales comme le loyer, l’électricité, et autres factures récurrentes; des dépenses bien moins visibles.
D’un autre côté, parmi les conjointes ayant un salaire plus élevé que leur partenaire, certaines (surtout celles de la configuration « mutualité conjugale ») soulignent la concrétisation d’une autonomie financière longtemps désirée grâce au projet de migration.
« J’ai toujours voulu mon autonomie financière donc je gère mes choses. Je ne veux pas qu’on me demande “ah t’as payé ça, pourquoi…” non non non. Je tiens à mon indépendance financière [rires]! » – Femme, un enfant, Côte d’Ivoire
Leur situation financière plus avantageuse grâce à une insertion rapide sur le marché de l’emploi au moment de l’installation offre un levier de négociation dans la gestion de l’argent au sein du couple. Par exemple, une gestion de l’argent axé sur le partage des dépenses au prorata. Toujours est-il que, même dans ce cas, la somme individuelle épargnée par la conjointe demeure souvent utilisée dans une perspective familiale plutôt qu’individuelle.
Le poids du projet migratoire
Différentes manières de vivre son couple, même constat général : les femmes dont la dynamique est celle du « projet conjugal » et de la « complémentarité conjugale » portent davantage le poids du projet migratoire et familial que leurs conjoints. Au-delà du paiement des factures, du maintien du budget et de la préparation face aux imprévus, les conjointes – et plus particulièrement celles ayant un revenu inférieur à leur partenaire – voient leur prise en charge des tâches ménagères augmenter comparativement à celle de leur conjoint.
« Je le vis bien aussi, parce que si maintenant [mon conjoint] me rabaissait toujours par rapport [au fait que je gagne moins], là c’est sûr que ça se passerait pas bien. Mais je trouve que c’est un ensemble, moi je fais énormément de tâches, que ce soit le linge ou d’autres choses. J’apporte plein de choses à la famille, donc pour moi c’est un ensemble. » – Femme, un enfant, France
Chez certaines, comme la conjointe d’un couple ayant deux enfants et originaire d’Algérie, un renforcement du « don de soi » concorde avec la réussite du projet migratoire et du bien-être de la bulle familiale. Cette femme priorise la réussite de ses enfants au Canada, pays d’accueil choisi, plutôt que ses propres gains financiers. Ce rôle de maîtresse du foyer est d’ailleurs accentué par le choix de résidence. Dans le marché immobilier québécois actuel, il n’est pas rare que le prix désiré, la proximité géographique ainsi que les critères de fonctionnalité et de propreté du logement souhaité par la conjointe ne puissent être remplis. Le poids de la décision résidentielle – bien que prise à deux – n’est pas partagé. La conjointe compense les inconvénients engendrés par ses critères résidentiels en augmentant ses tâches ménagères.
Le Québec, l’eldorado des couples hautement qualifiés. Ou presque…
Autrefois axé sur les opportunités professionnelles promises par le gouvernement du Québec, le projet migratoire se recentre autour de la priorisation de la famille une fois dans le pays d’accueil. Pour plusieurs couples rencontrés, peu importe leur dynamique, le repli sur la bulle familiale devient une solution de préservation face aux difficultés financières et professionnelles vécues. Ainsi, le maintien de la relation conjugale à travers le projet migratoire est une réussite en soi, car la séparation dans les années suivant l’immigration n’est pas un phénomène rare.
« Je te dis que nous avons des connaissances – pas des amis, mais quand même – que cette épreuve les a séparées. On a eu beaucoup de divorces [dans notre entourage] dans les premières années quand les couples sont arrivés. C’était soit tu restes ensemble et tu sors plus fort de la bataille, soit… » – Femme, deux enfants, Roumanie
Ensemble, les partenaires se soutiennent à travers cette importante transition et face aux difficultés rencontrées. Or, la résilience n’est pas un puits sans fond. Au fur et à mesure que les discriminations raciales s’accumulent, entre autres sur le marché de l’emploi et du logement, la rancœur envers la société d’accueil augmente. Le Québec comme chez soi permanent laisse tranquillement sa place à un projet migratoire circulaire où les couples souhaitent une mobilité entre le pays d’origine et le pays d’accueil.
Différents parcours migratoires, mêmes solutions?
L’immigration qu’elle soit économique ou non n’est pas sans défi. Dans le cas des couples d’immigrant·e·s hautement qualifié·e·s, elle engendre également une transformation de la gestion de l’argent et un repli sur la bulle familiale. Que peut faire la société d’accueil pour faciliter cette transition? D’une part, reconnaître l’impact du racisme sur l’intégration des personnes nouvellement arrivées au Québec afin de mettre en place des actions pour radier le phénomène dans les différentes sphères de la vie quotidienne. D’autre part, élargir les sujets abordés durant les interventions à l’arrivée des immigrant·e·s pour inclure les enjeux conjugaux qui peuvent survenir dans un contexte de difficultés liées au logement et à la recherche d’emploi et ainsi agir en amont auprès de ces couples. C’est en répondant à ces manques que les couples pourront retrouver leur envol et maintenir le cap vers le Québec.
- Les informations contenues dans l’introduction sont tirées du document « Les indicateurs de l’occupation et de la vitalité des territoires » du Gouvernement du Québec, par l’Institut de la statistique du Québec, consulté le 13 août 2024 à : https://statistique.quebec.ca/docs-ken/vitrine/occupation-vitalite-territoire/documents/demographie_02.pdf. ↩︎ ↩︎