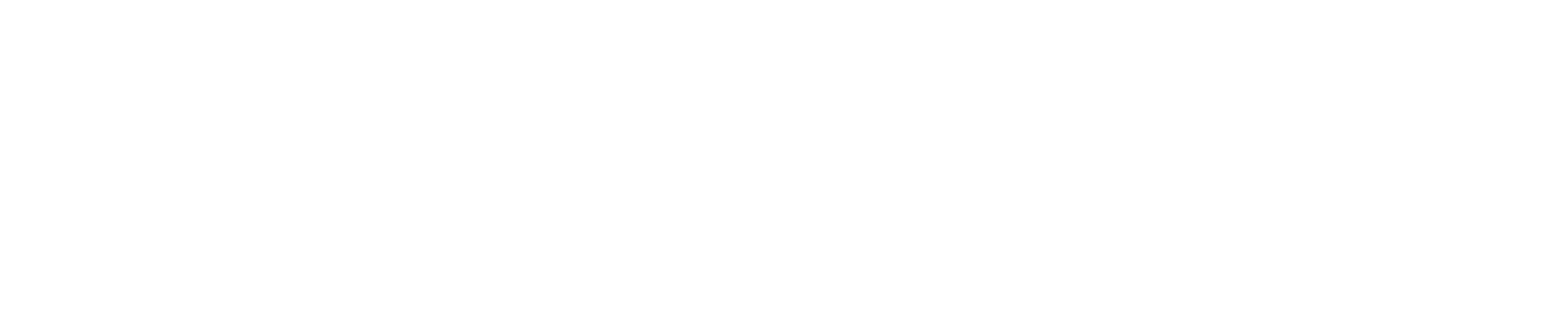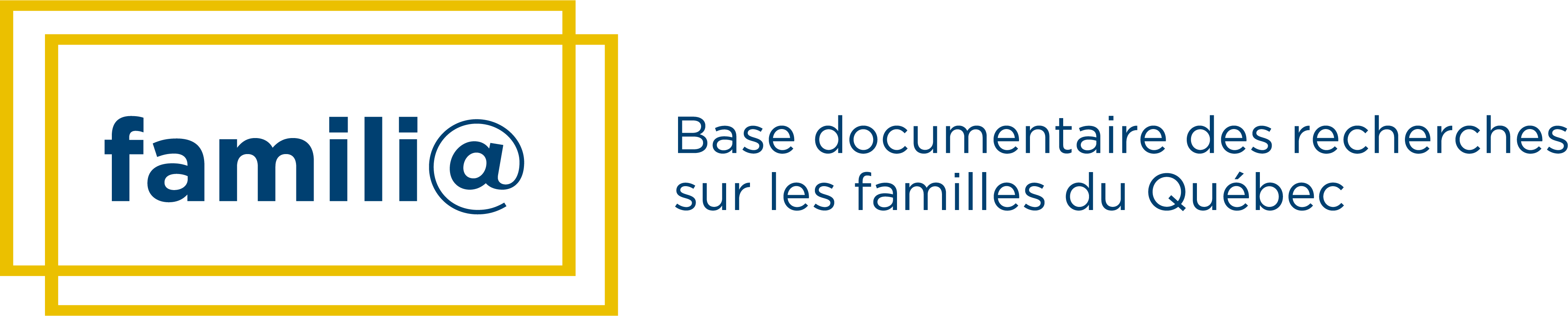Une maman préoccupée appelle le centre de la petite enfance « Les petits rêveurs ». Sur un ton inquiet, elle explique qu’Émile, son fils autiste de 3 ans, vient de nouveau de se faire refuser une place dans un service de garde éducatif. Faute de personnes éducatrices adéquatement outillées ou en effectifs suffisants, l’enfant se retrouve sans milieu pour l’accueillir. Or, cette fois, le gestionnaire répond à la maman « Il n’y a pas d’enfant qui soit « trop » en situation de handicap. Votre enfant est comme il est, et nous ferons tout ce qui sera nécessaire pour qu’il se porte bien, avec notre équipe. » Pour la jeune maman, le soulagement est immense.
Cette citation est celle d’un gestionnaire d’un centre de la petite enfance engagé dans l’inclusion et qui, pour y arriver, mise sur un levier essentiel : le développement professionnel de son équipe. En effet, les professionnel·le·s formé·e·s et outillé·e·s sont plus à même de faire évoluer les pratiques et de permettre un environnement où tous les enfants peuvent s’épanouir selon leur propre rythme.
C’est précisément cette réalité qu’une équipe de recherche de la Chaire UNESCO « Petite enfance et intervention précoce inclusive » de l’Université du Québec à Trois-Rivières cherche à mieux comprendre. Pour ce faire, elle mène une étude dans huit centres de la petite enfance (CPE) situés dans trois régions socio-administratives du Québec,1 un an après la mise en place d’un programme de perfectionnement professionnel. Les CPE concernés accueillaient au moins un enfant de 3 à 5 ans présentant un des diagnostics suivants : retards globaux de développement, autisme, retards langagiers et cognitifs, difficultés langagières, difficultés langagières et sensorielles ou difficultés motrices. Les équipes ont été formées à un outil d’évaluation et de planification pour intervenir de manière ciblée auprès d’eux et effectuer le suivi de leurs progrès selon huit critères : motricité fine, motricité globale, capacités d’adaptation, communication sociale, cognition, littératie et mathématiques. Cette recherche s’inscrit dans un projet plus vaste, qui réunit 19 organisations engagées à améliorer l’inclusion dans les centres de la petite enfance au Québec, et repose sur les témoignages de 14 éducatrices et de 6 gestionnaires.
Mission inclusion
À quoi réfère-t-on lorsqu’on parle d’inclusion dans les milieux accueillant les tout-petits et pourquoi est-ce important? Dans ce contexte, l’inclusion peut prendre la forme de pratiques et d’actions mises en place pour accueillir les enfants dans toute leur diversité et ainsi favoriser un sentiment d’appartenance, peu importe leurs besoins et particularités. Le résultat? Des milieux d’apprentissage plus équitables et une société plus ouverte aux différences. Pour y arriver, de nombreux facteurs entrent en jeu. Ils sont liés à la culture, à l’engagement des ressources dédiées à l’accueil des enfants, au partage des connaissances en intervention — à travers la formation par exemple — ou encore aux politiques du gouvernement et des CPE. Au Québec, c’est à ces derniers que revient la responsabilité d’accepter ou non des enfants à besoins particuliers. En effet, aucune politique n’existe pour coordonner l’inclusion dans les structures d’accueil de la petite enfance. C’est là où le développement professionnel revêt une grande importance.
En recentrant les pratiques sur le développement de chaque enfant, peu importe le stade où il se trouve, le développement professionnel aide les équipes en petite enfance à mieux comprendre et accueillir la diversité des tout-petits.
« Ce n’est donc pas seulement que X est différent; c’est que X se trouve à un certain stade dans son développement moteur et à un autre stade dans son développement linguistique ». [Traduction libre]
— Une éducatrice
Avancer un défi à la fois
Concrètement, comment s’exprime cette inclusion facilitée par le développement professionnel? Chez les personnes éducatrices, elle passe par un ajustement des activités quotidiennes aux besoins différents des enfants. Ainsi, pour une même activité, il n’est pas attendu que chaque enfant soit au même niveau, mais bien que chacun d’entre eux ait la chance de travailler sur ses propres défis.
Leur formation permet dans un premier temps de gagner en capacité d’observation et d’identification des besoins des tout-petits, le tout facilitant de meilleures stratégies d’intervention. Elles ont également l’occasion de perfectionner un vocabulaire partagé avec les gestionnaires et autres professionnelles, comme les psychologues. Ainsi, elles rapportent être plus à même d’identifier et de nommer avec les mots précis les succès et défis des enfants et de planifier des objectifs et opportunités d’apprentissage ciblés.
« Connaître davantage les dimensions du développement et réaliser un portrait de groupe m’aide à savoir quoi faire à différents moments de la journée, non seulement dans le cadre d’activités ciblées, mais aussi dans le cadre des routines. » [Traduction libre]
— Une éducatrice
Peu importe où ils se trouvent dans leur développement, les enfants peuvent donc relever des défis personnalisés. En bout de ligne, une telle approche est non seulement respectueuse du rythme des enfants, mais elle leur offre la possibilité de fêter leurs petites victoires et de développer un sentiment de compétence.
S’outiller pour mieux outiller
Si les personnes éducatrices sont en première ligne pour créer des environnements plus inclusifs, les gestionnaires aussi jouent un rôle central, notamment par la mise en place de solutions concrètes. Des exemples? Lorsque les budgets le permettent, embaucher du personnel éducatif supplémentaire ou réduire le ratio enfants/employé·e·s afin de donner à chacun·e plus de temps pour mieux accompagner chaque enfant selon ses besoins. Ce type de décision témoigne de l’importance du leadership, largement souligné dans l’étude. En effet, pour favoriser des environnements inclusifs, il faut que l’équipe comprenne et adhère à l’idée selon laquelle l’inclusion est une responsabilité partagée. Créer une vision commune — ce qui est précisément le rôle des gestionnaires — apparaît alors essentiel. À cette fin, le développement professionnel facilite leur travail en leur fournissant des outils pour créer un environnement de travail collaboratif.
De plus, cette formation leur permet de développer des compétences en communications, planification, organisation, résolution de problèmes et travail d’équipe. Ces apprentissages leur permettent alors de mieux soutenir les personnes éducatrices, qui peuvent à leur tour mieux soutenir tous les enfants.
Quand l’inclusion bénéficie à tout le monde
Si l’histoire du petit Émile illustre une réalité encore trop fréquente, la présente étude apporte un vent d’espoir; une solution concrète pour réduire l’exclusion en CPE. En renforçant les compétences des équipes en petite enfance, le développement professionnel nourrit la confiance, améliore la collaboration et permet de mettre en œuvre des méthodes d’intervention qui soutiennent le développement des tout-petits.
L’amélioration des pratiques des personnes éducatrices bénéficie d’ailleurs à tous les enfants, qu’ils aient besoins particuliers ou non. En effet, les compétences développées par celles-ci ne ciblent pas que les enfants avec des difficultés, mais bien tous les enfants selon l’endroit où ils se trouvent dans leur cheminement. En fin de compte, le développement professionnel permet d’élever la qualité de l’éducation pour l’ensemble des tout-petits.
- Un centre était situé dans une zone urbaine, tandis que les 7 autres se trouvaient dans des villes de petite ou moyenne taille. ↩︎