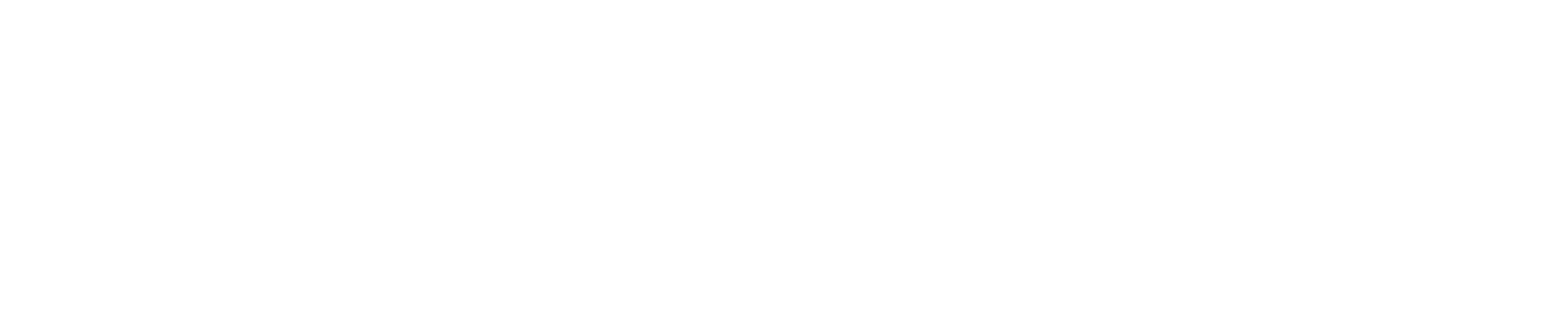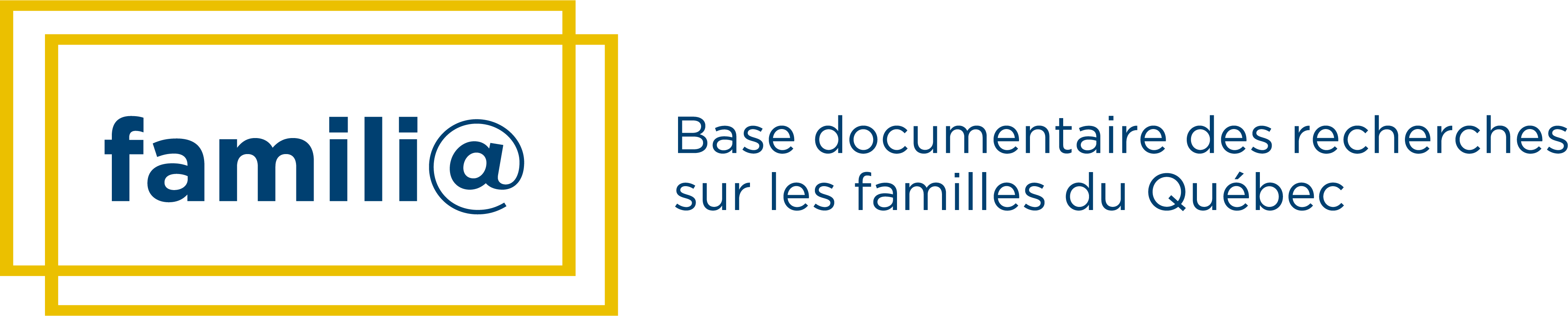La pauvreté et le recours à l’assistance sociale sont souvent abordés sous un angle individuel, centré sur la capacité à travailler. Pourtant, cette approche tend à occulter l’expérience concrète de la précarité, et à négliger d’autres dimensions essentielles. Parmi celles-ci, la famille et le couple jouent un rôle déterminant dans les trajectoires menant à l’assistance sociale. En effet, les récits des personnes en situation de précarité soulignent l’importance de ces liens dans leur parcours de vie. Majoritairement issus de groupes fragilisés par un soutien limité – personnes seules, mères et pères monoparentaux – ces personnes mettent en lumière l’ambivalence du rôle de la famille, qui peut être tour à tour une ressource précieuse ou une source possible de grande vulnérabilité. Dès lors, comment le couple et la famille influencent-ils l’expérience de celles et ceux qui sont soutenus par cette mesure de solidarité sociale?
Une équipe de recherche de l’Université du Québec à Montréal, de l’Université McGill et de l’Université TÉLUQ a donné la parole à 105 personnes qui vivent de l’assistance sociale, sélectionnées auprès d’organismes communautaires répartis dans sept régions du Québec : Ville de Québec, Montréal, Estrie, Outaouais, Lanaudière, Montérégie et Bas-Saint-Laurent. La démarche vise à faire émerger des récits permettant de mieux saisir leurs points de vue sur la pauvreté. Ces personnes participent à des entretiens de groupes dans lesquels elles abordent des thèmes liés à leur parcours et leurs conditions de vie. Les groupes sont constitués de manière à refléter une diversité d’expériences, d’âges, de genres, de statuts de citoyenneté, de situations familiales et de contextes de handicap.
Partir, mais à quel prix?
Tensions conjugales, ruptures ou situations de violence : les parcours de vie menant à la précarité sont traversés de nombreuses épreuves. Cette réalité ressort fortement des témoignages recueillis, particulièrement chez les femmes. Ainsi, les familles monoparentales ayant une femme comme cheffe de famille se trouvent dans des situations généralement plus précaires que les familles monoparentales avec un père à la tête de la famille. Plusieurs participantes expliquent que c’est justement lorsque le besoin de quitter le conjoint a émergé – parfois dans un contexte de violence physique, psychologique ou économique – qu’elles se sont retrouvées sans revenu et sans réseau de soutien.
La séparation agit donc comme un moment charnière dans les trajectoires de vulnérabilité. Dans plusieurs cas, les femmes assument la majorité des tâches domestiques et des soins aux enfants, ce qui les éloigne durablement du marché du travail. Cette répartition inégalitaire au sein du couple a des effets concrets : au moment de la rupture, elles se retrouvent souvent sans emploi, sans accès à un revenu propre et dans l’impossibilité de subvenir seules aux besoins de leur famille. La dépendance économique joue alors un rôle clé dans la trajectoire familiale et le recours aux programmes d’assistance sociale.
« Mon chum travaillait, fait que, quand je l’ai… quand je l’ai fichu dehors, ben, j’ai pas eu le choix. Y’a fallu que je fasse de quoi. Mais avec un bébé, de… y’avait 18 mois, pis, y’avait pas de garderie, y’avait rien… » – Une des personnes participantes.
À cette situation s’ajoutent des contraintes administratives qui renforcent la dépendance économique; l’une des principales étant celle du calcul des prestations d’aide sociale basé sur le revenu du ménage. Ainsi, même en contexte de violence ou de séparation, les revenus des deux personnes sont pris en compte, ce qui peut empêcher l’accès à l’aide et compliquer la décision de partir. De plus, pour pouvoir recevoir certaines prestations, comme une pension alimentaire, les femmes doivent parfois entamer des démarches judiciaires contre leur ex-partenaire. En conséquence? La fragilisation d’une relation déjà difficile et une augmentation des tensions conjugales post-séparation.
Ce basculement dans la pauvreté lié à une séparation n’est pas rare : les familles monoparentales représentent la deuxième catégorie la plus présente dans les programmes d’assistance sociale.
La famille : une ressource bien souvent compromise
« On ne choisit pas sa famille », et encore moins le rôle qu’elle joue dans une trajectoire de vie menant à la précarité. En effet, si la famille peut représenter une ressource, tant matérielle, émotionnelle que logistique, cette aide est loin d’être accessible à toutes et tous.
Aide financière ponctuelle, hébergement temporaire, écoute ou encore aide pour la garde d’enfants : ce filet familial agit, dans plusieurs cas, comme un levier de protection contre l’isolement et un appui pour traverser des périodes de grande instabilité.
Toutefois, pour d’autres, ce filet de sécurité est absent, insuffisant ou trop fragile pour être réellement soutenant. Lorsque les proches vivent également dans une grande précarité, demander de l’aide est loin d’être une option. Pour certain·e·s, ce sont des conflits familiaux, des ruptures de lien, un manque de disponibilité ou bien les exigences mêmes du système d’assistance sociale qui limitent, découragent ou empêchent ce recours. En effet, une aide financière familiale, comme un don ou un héritage, pourrait disqualifier leur admissibilité à certains programmes d’assistance sociale. L’appui familial devient ainsi difficile à mobiliser.
Une séparation conjugale, un contexte de violence, ou encore l’éloignement géographique sont autant de facteurs concrets qui réduisent l’accès à ce soutien familial. C’est notamment le cas des femmes immigrantes, pour qui l’éloignement du réseau familial rend l’expérience de précarité encore plus difficile à vivre, tant économiquement que relationnellement.
« Je suis à l’aide sociale parce que je n’ai pas personne ici pour m’aider, et je suis avec ma fille, et, depuis que je suis venue, […] Je n’ai pas personne pour la garder pour que je puisse, travailler. » – Une des personnes participantes.
Ainsi, il devient difficile, voire impossible, de faire appel aux personnes qui pourraient assurer un filet de sécurité, renforçant l’isolement et l’insécurité vécus au quotidien.
En l’absence de soutien? Des stratégies d’adaptation
Qu’il y ait un soutien familial ou non, les personnes en situation de précarité doivent faire preuve d’ingéniosité. Ainsi, elles développent de multiples stratégies d’adaptation, qui demandent constamment beaucoup de temps et d’énergie. Le recours aux banques alimentaires, la chasse constante aux rabais, la participation à des cuisines collectives, ou encore la réduction de certaines dépenses alimentaires sont évoqués dans plusieurs témoignages. D’autres surveillent méticuleusement chaque dépense, organisent leur budget au jour près ou tentent d’obtenir de l’aide auprès d’organismes communautaires.
« Je m’en vais à Mission Bon Accueil, mais c’est très loin. C’est deux heures et demie là. Et puis, aller là en transport en commun, le métro, c’est pas évident non plus là. Bon, mais on le fait pareil. » – Une des personnes participantes.
En plus d’être chronophages, ces efforts demandent une attention soutenue et une grande capacité d’organisation, dans un contexte de fatigue, de stress et d’instabilité.
« […] quand une fois, on a connu une galère, par exemple, de pas avoir de nourriture chez nous, on apprend à anticiper, à remplir les placards, au moins […] de riz, de choses de base pour être sûr de pouvoir nourrir notre enfant. […]. » – Une des personnes participantes.
Quand le soutien familial ou conjugal fait défaut, ces stratégies deviennent non seulement une nécessité, mais aussi un fardeau supplémentaire. Elles illustrent un état de gestion permanente de la survie, où chaque geste du quotidien est orienté vers le maintien d’un équilibre déjà fragile. Elles fonctionnent comme un engrenage, contribuant à ancrer les personnes dans leur situation d’assistance sociale.
Famille, épreuves et préjugés : changer de regard sur l’aide sociale
Les trajectoires de pauvreté s‘entrelacent avec d’autres formes de vulnérabilité – comme le genre, le statut migratoire ou une situation d’handicap – amplifiant les épreuves vécues au quotidien. Pour plusieurs, la famille n’est pas ce pilier que l’on imagine. Les témoignages recueillis révèlent des situations où les difficultés s’accumulent : ruptures conjugales, charge domestique inégale, absence de réseau, règles administratives qui découragent l’aide familiale… Ils montrent également que le soutien familial ne va pas de soi, et qu’il est bien souvent fragilisé par des tensions ou des obstacles économiques qui compliquent l’entraide.
Au-delà de ces difficultés, ces personnes doivent aussi composer avec la stigmatisation associée à l’aide sociale, qui teinte leur regard sur elles-mêmes et sur le soutien reçu. Ce jugement, parfois relayé par leurs proches, renforce leur sentiment d’isolement, assombrit leur expérience de vie et rend invisibles les efforts et les ressources qu’elles mobilisent pour s’en sortir et (sur)vivre.
Reconnaître les parcours de vie dans leur globalité, incluant les réalités conjugales, familiales et les rapports de dépendance affective, économique et sociale qui y sont associés, pourrait être un pas la bonne direction. Adopter une telle vision permettrait de mieux adapter les dispositifs de soutien aux vécus réels et de rompre avec une approche réductrice projetant une image stigmatisante des personnes vivant en situation de précarité.