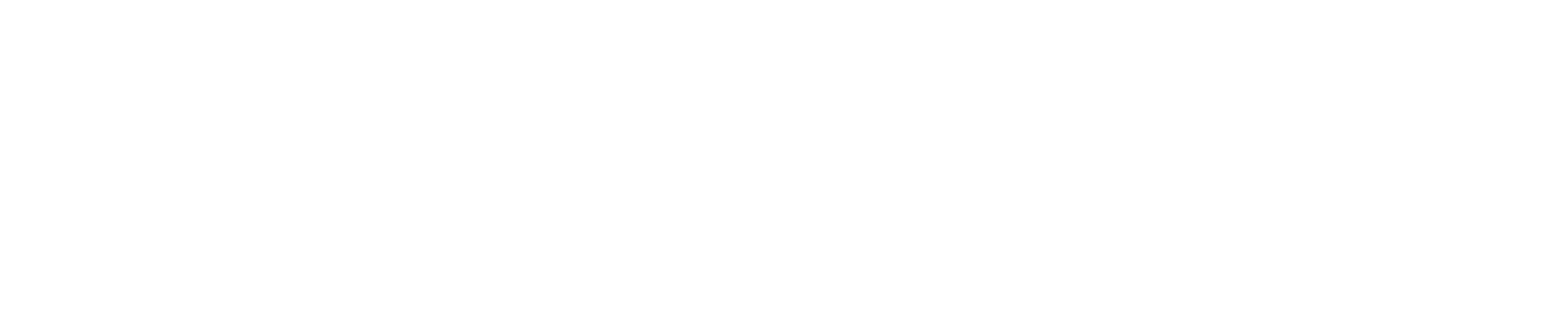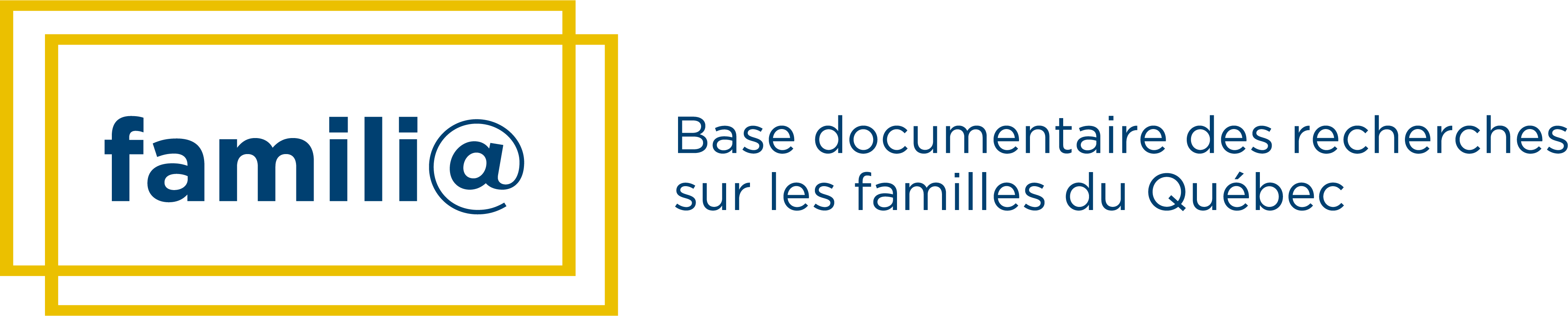Les personnes qui décident de migrer vers un autre pays s’exposent à des stress importants. Le projet d’immigration s’accompagne de deuils et de plusieurs changements familiaux, sociaux et économiques. Les nombreux chocs auxquels elles sont confrontées exigent d’elles une grande résilience. Si l’intégration des familles immigrantes dans leur nouveau milieu peut être ardue, divers facteurs, dont certains indépendants de leur volonté, peuvent toutefois faciliter leur adaptation et renforcer leur résilience. Lesquels? La culture, l’éducation, le réseau communautaire, l’environnement social et l’emploi semblent exercer une influence importante.
Une équipe de recherche de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue s’intéresse aux facteurs de protection externe qui favorisent l’adaptation et la résilience des familles immigrantes dans la région. Des entrevues réalisées auprès de 28 familles originaires de l’Amérique latine, de l’Amérique du Nord, de l’Afrique et de l’Europe permettent d’en identifier cinq qui agissent comme mécanismes de soutien.
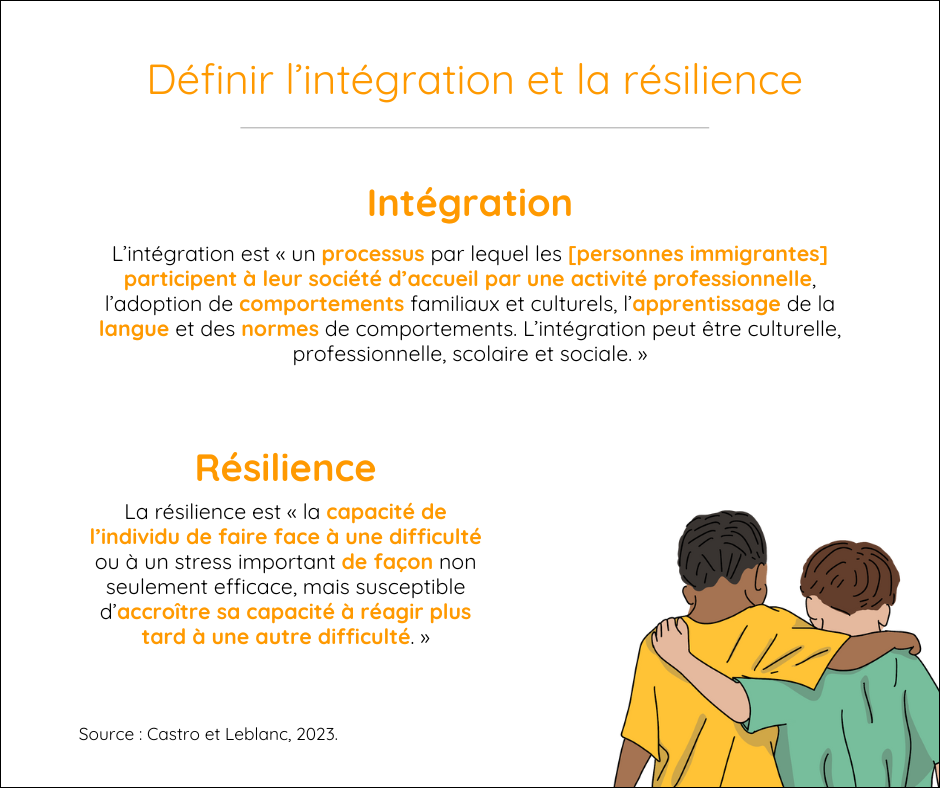
La culture d’abord!
Au premier plan? La culture. Cinq participant·e·s sont d’avis que s’ouvrir aux gens de la culture d’accueil – témiscabitibienne ou québécoise – est primordial pour réussir son immigration. Faire preuve de cette même ouverture envers les autres cultures fait également partie de l’équation.
« Essayer de ne pas chercher seulement des gens de sa propre culture. […] Les gens d’autres cultures peuvent mieux comprendre mes souffrances, mes réussites et tout ce que j’ai vécu, parce qu’ils sont aussi passés par là, comme moi […| » – Pierre
Selon deux personnes interrogées, intégrer la culture d’accueil passe par le respect de celle-ci et la participation aux activités des Québécois·e·s, même si elles sont bien différentes de celles que la famille pratiquait dans son pays d’origine.
« […] la chasse à l’orignal, à l’ours, etc. […] Cela ne se fait pas dans mon pays [Argentine], au moins, d’où je viens. Alors ce sont des choses qui sont propres d’ici, de la culture d’ici et c’est bien, c’est correct pour eux. C’est ce que j’explique à mes enfants, qu’il faut respecter la différence. » – Adama
Pour les familles interrogées, s’entourer de gens qui partagent la même origine culturelle ou géographique est aussi essentiel. Cela permet de tisser des liens et de retrouver des habitudes de son pays d’origine. C’est également une façon de maintenir un certain équilibre entre les valeurs de la culture d’accueil et celles de son pays d’origine.
Socialiser et créer des liens
Lorsqu’elles sont interrogées sur la façon dont elles ont été accueillies par les résident·e·s de la région, les familles interrogées nomment s’être senties bien reçues. Elles parlent de la région comme d’un environnement social accueillant, et définissent les Témiscabitibien·nes comme des « personnes vraies ». À leur arrivée les participant·e·s cherchent à s’informer sur les services disponibles. Cela les amène à fréquenter le même organisme communautaire – la Mosaïque – où commencer à se construire un réseau devient alors possible.
« La Mosaïque, ça nous a permis, dans les premières années, peut-être, de socialiser un peu. » – Virginie
Les relations interpersonnelles semblent jouer un rôle important dans le parcours des répondant·e·s qui disent saisir les opportunités de faire des activités avec des ami·e·s en y incluant leur(s) enfant(s). Faire « du social, en famille », comme le dit Charles, un participant de l’étude, permet à chacun·e de répondre à son besoin individuel de socialisation, puis d’offrir à l’ensemble de la famille des possibilités de se développer. Neuf participant·e·s précisent toutefois que ces nouveaux rapports sociaux ne se bâtissent pas de n’importe quelle façon :
« […] Si je veux conserver mes amis pour la vie, je dois prendre soin d’eux et les respecter et, comme ma mère disait, les accepter avec leurs défauts, si tu fais ça, tu auras des amis pour la vie. Ici, après ta famille, ce sont tes amis qui comptent le plus. – Aya
Les deux tiers des personnes interrogées déclarent que les activités proposées par la municipalité contribuent également à élargir leur réseau. Lors de ces rencontres, elles font la connaissance de personnes de la même origine qu’elles et créent des liens significatifs avec d’autres d’origine québécoise. Dix participant·e·s choisissent de faire du bénévolat pour faciliter leur intégration. La plupart affirment que cela leur permet de faire des rencontres, de recevoir des conseils et de parvenir à maîtriser la langue, élément essentiel pour se trouver un emploi rémunéré.
L’école comme facilitateur
Combien de personnes sont concernées par un retour aux études? La majorité. Même s’ils et elles ont obtenu un diplôme dans leur pays d’origine, beaucoup de participant·e·s doivent reprendre des études de 2e ou de 3e cycle universitaire à leur arrivée dans la région, ou faire un baccalauréat dans un autre domaine. Ces personnes considèrent toutefois les études universitaires comme un élément positif dans leur parcours. Lorsqu’elles sont admises dans le programme d’études qu’elles choisissent, elles disent se sentir acceptées par la région et éprouver un sentiment de gratitude. Pour elles, c’est l’opportunité de développer leurs compétences dans un environnement où elles se sentent à leur place. Pour un grand nombre de participant·e·s, l’université rend la recherche d’emploi et la création de liens sociaux plus faciles. La plupart sont d’avis que l’université facilite l’intégration.
« J’avais un diplôme dans le domaine de l’administration. Cela ne me servait pas pour me trouver du travail dans l’administration. […] je me suis inscrite dans un programme de 2e cycle. Peu de temps après, j’ai eu mon premier travail. » – Emma
S’il est vrai qu’une proportion importante des personnes interrogées a dû faire un retour aux études, certaines ont toutefois pu faire reconnaître leurs diplômes. Cette possibilité de reconnaissance à influencé trois familles à choisir la région de l’Abitibi-Témiscamingue pour étudier, vivre et séjourner de façon définitive.
Et si l’école facilite l’intégration des parents, elle aide aussi celle des enfants. Lorsque ces derniers sont acceptés rapidement et facilement par les établissements scolaires, cela contribue favorablement au processus d’adaptation de la famille. Lorsque leur(s) enfant(s) intègrent l’école, les parents ressentent une certaine paix d’esprit et l’anxiété diminue chez tous les membres de la famille.
Travailler, une réelle façon de s’intégrer
L’école est considérée comme un facilitateur par les répondant·e·s; le travail, quant à lui, est perçu comme une chance réelle de s’intégrer à la région. Puis avoir un emploi donne également accès à plusieurs autres opportunités, comme celle d’apprendre la langue:
« Le fait de trouver un emploi, tu vas aller apprendre mieux ton français, tu vas te pratiquer, tu vas sociabiliser, tu vas aussi avoir d’autres opportunités » – Virginie
Travailler suscite, chez les personnes interrogées, le sentiment d’être utiles, visibles dans la société québécoise et de participer au développement de la région. Quinze répondant·e·s affirment que le travail leur procure de la satisfaction et de la fierté et qu’il les aide à cheminer.
Pour favoriser la résilience …
Le parcours post-migratoire est parsemé de défis, mais certains éléments peuvent aider les personnes immigrantes vivant en Abitibi-Témiscamingue à affronter les difficultés qu’elles croisent sur leur chemin. La capacité de conserver certains acquis de sa culture d’origine, tout en intégrant des aspects de la culture d’accueil, l’existence de lieux où il est possible d’obtenir des informations sur le fonctionnement de la ville, l’accès à des activités sociales, la possibilité de faire du bénévolat et la création de nouveaux liens significatifs agissent comme facteurs de protection. De son côté, l’intégration rapide des enfants à l’école facilite le processus d’adaptation. La fréquentation d’une institution scolaire par les parents semble, quant à elle, simplifier la recherche d’emploi. Et le travail représente une opportunité concrète, d’intégrer leur nouveau milieu et de participer au développement de la société qu’ils ont rejointe. Favorisée par cet ensemble de facteurs qui touchent à la sphère culturelle, communautaire, sociale, scolaire et professionnelle, la résilience des répondant·e·s les aide à s’adapter à leur nouvelle réalité.