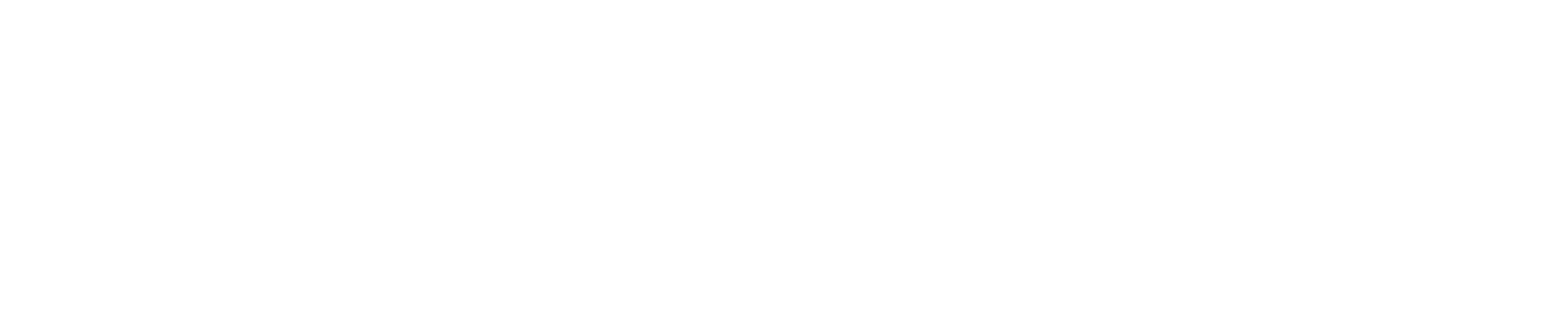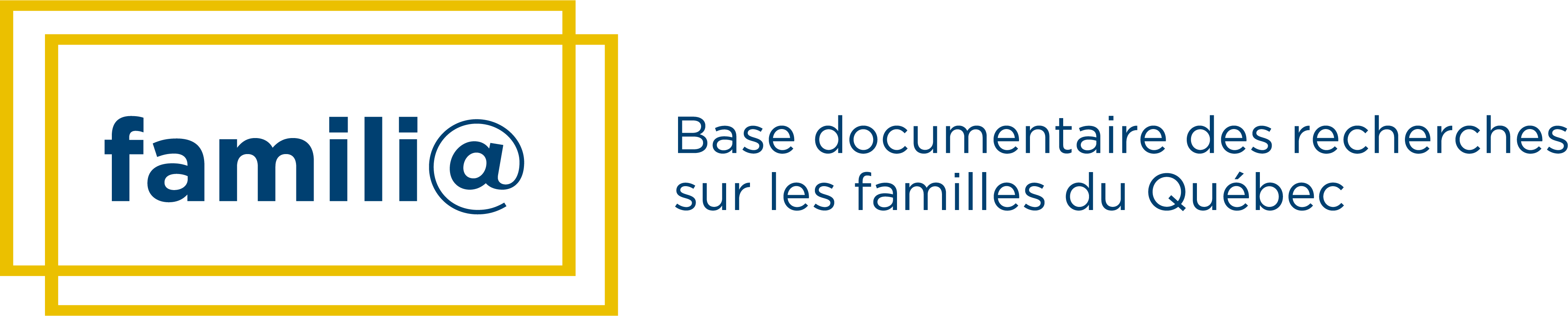La naissance d’un premier enfant est souvent imaginée comme un moment de joie et d’épanouissement, marquant une transition essentielle vers la parentalité. Pourtant, lorsque cette naissance survient prématurément, elle transforme profondément l’expérience des parents, leur imposant une adaptation rapide et bouleversante. Entre le deuil d’une grossesse idéalisée, l’angoisse liée à la santé du bébé et la réorganisation des rôles conjugaux et parentaux, les parents vivent une réalité marquée par l’incertitude et un engagement intense.
Afin de mieux comprendre l’impact de la prématurité sur la transition à la parentalité, deux chercheuses de l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval donnent la parole à des parents ayant vécu une première naissance prématurée. Des entrevues avec six couples hétérosexuels québécois recrutés par l’intermédiaire d’organismes communautaires et du bouche-à-oreille sont menées. Les couples sélectionnés devaient vivre ensemble depuis au moins 9 mois, être en mesure de s’exprimer en français, et avoir eu un premier enfant né avant 37 semaines de gestation et âgé de 6 à 18 mois au moment de l’étude.
La prématurité ou comment devenir parent abruptement
Devenir parent du jour au lendemain n’est pas chose aisée. La naissance d’un premier enfant marque un changement fondamental pour les couples, imposant l’acquisition rapide de compétences parentales et la création d’une dynamique conjugale inédite. Il arrive cependant que cette période de transition se voie écourtée et accélérée. C’est ce à quoi font face les couples vivant une naissance prématurée. Définie comme un accouchement survenant avant 37 semaines complètes de grossesse, cet événement peut être perçu comme étant traumatisant, notamment en raison de l’incertitude médicale et de l’hospitalisation prolongée du bébé.
Son impact est particulièrement fort pour les parents d’un premier enfant, car elle impose un changement encore plus rapide dans la dynamique du couple. Ils doivent non seulement gérer les enjeux liés à la prématurité, mais aussi revoir leurs attentes liées aux circonstances de la naissance et apprendre à naviguer dans une nouvelle réalité marquée par l’inquiétude. Stress intense et exigences liées aux soins du nourrisson peuvent alors fragiliser la relation conjugale.
Entre naissance imaginée et naissance réelle
Lorsque la naissance prématurée d’un enfant frappe les couples, elle précipite inévitablement le moment de devenir parent. En comparaison avec ceux ayant un enfant né à terme, la relation conjugale entre les parents s’en trouve chamboulée différemment. Ces derniers se retrouvent confrontés à un triple deuil : celui d’une grossesse idéalisée, de l’espoir d’un accouchement sans complications et d’un nouveau-né en parfaite santé.
« Au début, je ne savais pas quoi faire, j’étais sous le choc. Je ne m’attendais pas à un accouchement aussi tôt que ça. » – Maude, maman d’un enfant prématuré.
Cette interruption soudaine de la grossesse les confronte à un stress émotionnel intense, d’autant plus que la prématurité s’accompagne souvent d’un risque élevé de problèmes de santé graves. L’accouchement est alors vécu comme un choc, souvent accompagné de sentiments d’échec, de peur et d’impuissance. Les mères vivent la mise au monde précoce du bébé comme une dépossession corporelle, en particulier celles vivant un accouchement par césarienne.
« Je ne m’étais jamais sentie aussi vide parce que ça faisait quand même six mois et trois semaines là que je le portais, et que là, je n’étais plus accompagnée. » – Léa, maman d’un enfant prématuré.
De leur côté, quatre des six pères participant à l’étude disent mieux se remettre que la mère, principalement car ils ont la possibilité de jouer un rôle actif dans les premières heures qui suivent la naissance. D’autres éprouvent, eux aussi, une détresse émotionnelle importante, demandant un soutien auprès de leur conjointe.
Bien souvent, ce sentiment anxiogène est également intensifié par la séparation physique obligée. En effet, le bébé est confié aux soins du personnel médical dans l’unité néonatale pour une hospitalisation prolongée.
L’hospitalisation : une épreuve de plus dans le développement de la relation parentale
En plus de la naissance précipitée, l’hospitalisation du bébé prématuré s’ajoute au bouleversement profond de l’expérience parentale. Pour de nombreux parents, rentrer à la maison sans leur nouveau-né génère un sentiment d’irréalité et met en suspens leur rôle parental. L’apparence chétive de leur bébé peut également influencer leur attachement. Mais, il n’y a pas que l’image de leur nourrisson qui perturbe leur lien affectif. Certains vivent difficilement la présence des équipements médicaux pourtant indispensables aux soins intensifs. Cette barrière matérielle agit également comme une barrière émotionnelle. La distance entre eux et leur bébé, ainsi que leur impression de perte de contrôle s’en trouvent alors amplifiées.
Quant au séjour en unité néonatale, il est loin d’être calme. Il confronte les parents à un flux constant d’informations médicales et à une évaluation permanente de l’état de santé de leur bébé. Cette avalanche de nouvelles changeantes met à l’épreuve leur capacité à s’adapter aux changements et à gérer le stress qui en découle. Leur sentiment d’impuissance se trouve alors exacerbé par leur incapacité à agir directement pour améliorer le sort de leur enfant.
« T’écoutes pas vraiment, même s’il fallait que tu portes attention, parce qu’ils t’expliquent que ton enfant va bien. » – Samuel, papa d’un enfant prématuré
Pourtant, ce passage obligé constitue aussi une étape clé dans la construction de l’identité parentale. Lorsque soutenus par le corps médical, les parents apprennent progressivement à s’approprier leur nouveau rôle en prenant en charge les besoins et en cherchant comment développer un lien avec leur enfant, en dépit des circonstances. Véritable défi dans la transition vers la parentalité, cette expérience les amène à élaborer des stratégies d’adaptation, à s’investir activement dans les soins et redéfinir leur implication en fonction des réalités imposées par la prématurité.
Se forger une parentalité solide après la sortie de l’hôpital
Bien que les nouveaux parents ressentent de la joie à l’idée de quitter l’hôpital, la majorité d’entre eux, et particulièrement les pères vivent de l’anxiété lors de leur retour à la maison. S’investir dans les soins du bébé, notamment à travers le contact peau à peau, l’allaitement et l’apprentissage des gestes du quotidien leur permet de passer d’un rôle de spectateur passif à celui de parent investi. En bout de ligne, cet engagement apparait comme un moyen de lever le brouillard sur leurs doutes, puisqu’elle renforce leur sentiment de compétence parentale et favorise l’attachement.
La solidarité au sein du couple joue également un rôle clé dans cette transition. Les parents qui communiquent et s’épaulent mutuellement développent des stratégies de résilience communes. En revanche, ceux dont la relation était déjà fragile peuvent voir les tensions persister et leur éloignement s’accentuer. Pour ces derniers, la transition à la parentalité a tendance à se développer de façon solitaire.
Également, le rapport qu’entretient le couple avec ses proches est à prendre en compte. En ce sens, lorsque les personnes qui les entourent ont des réactions jugées négatives, les parents ont tendance à s’isoler et à se concentrer exclusivement sur les progrès de leur bébé. En outre, le soutien mutuel qui en découle agit alors comme un facteur de résilience face au choc, à l’anxiété et, parfois, aux mauvaises nouvelles liées à l’hospitalisation.
Enfin, certains couples ont confié avoir trouvé un grand réconfort dans leurs croyances religieuses ou spirituelles pour traverser le choc émotionnel. Celles-ci les ont aidés à accepter la situation et à se recentrer sur l’évolution de l’état de santé de leur bébé.
L’expérience de la naissance prématurée marque durablement la parentalité, influençant les décisions et perceptions des futures grossesses. Certains parents, hantés par la crainte d’une récidive, renoncent à avoir un autre enfant, tandis que d’autres adoptent une approche plus prudente, renforçant leur vigilance lors du suivi médical. Pour certains, une nouvelle grossesse devient une chance de revivre différemment cette période, avec l’espoir de concrétiser l’expérience idéalisée de la parentalité.
Un accompagnement adéquat pour une parentalité mieux préparée
La naissance prématurée chamboule profondément la transition à la parentalité, obligeant les parents à s’adapter à une réalité imprévue et éprouvante. Entre l’angoisse liée à la santé du bébé et la séparation imposée par l’hospitalisation, ils doivent construire leur rôle parental dans un contexte rempli d’incertitudes.
Cette étude met en évidence la nécessité de préparer tous les futurs parents à la possibilité d’une naissance prématurée. Le manque de connaissances de nombreux couples à ce sujet révèle l’importance de les sensibiliser davantage dès les premiers suivis de grossesse. Le développement d’interventions sensibles et ciblées en adéquation avec la réalité spécifique vécue par les parents d’enfants prématurés constitue un enjeu fondamental. La pertinence d’un accompagnement visant particulièrement à faciliter la transition entre l’environnement hypermédicalisé de l’unité néonatale et le retour à la maison, souvent source d’anxiété pour les nouveaux parents, s’impose comme une évidence. La mise en place de services spécialisés en soutien à l’allaitement et en accompagnement au contact peau à peau en contexte de prématurité est également recommandée.
Ces pistes d’intervention peuvent avoir un impact significatif sur la construction d’une parentalité confiante et engagée, aider à favoriser l’attachement parent-enfant et contribuer à diminuer le stress et l’insécurité vécus par les nouveaux parents. Si la naissance d’un enfant avant terme impose une transition brutale vers cette nouvelle étape, elle peut aussi être une opportunité pour les parents de se développer de manière plus consciente et engagée, à condition de bénéficier du soutien nécessaire.