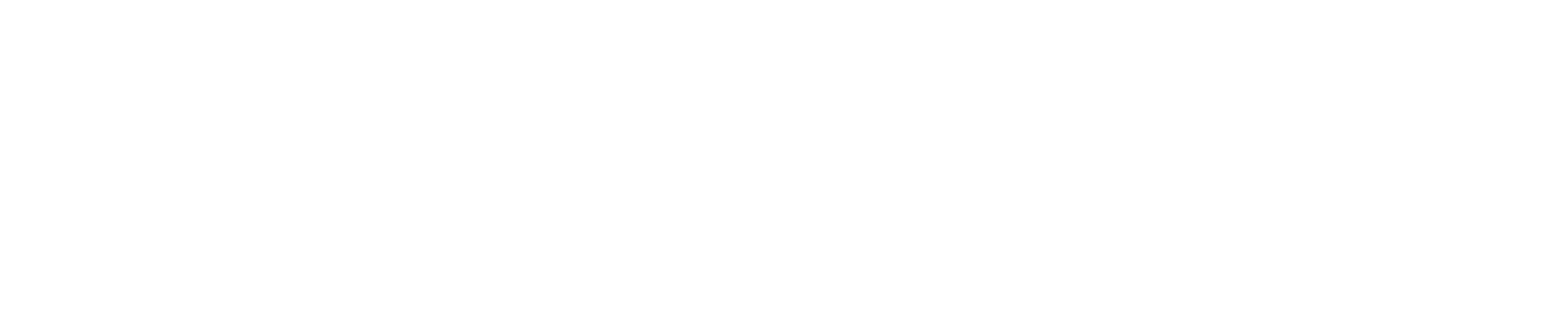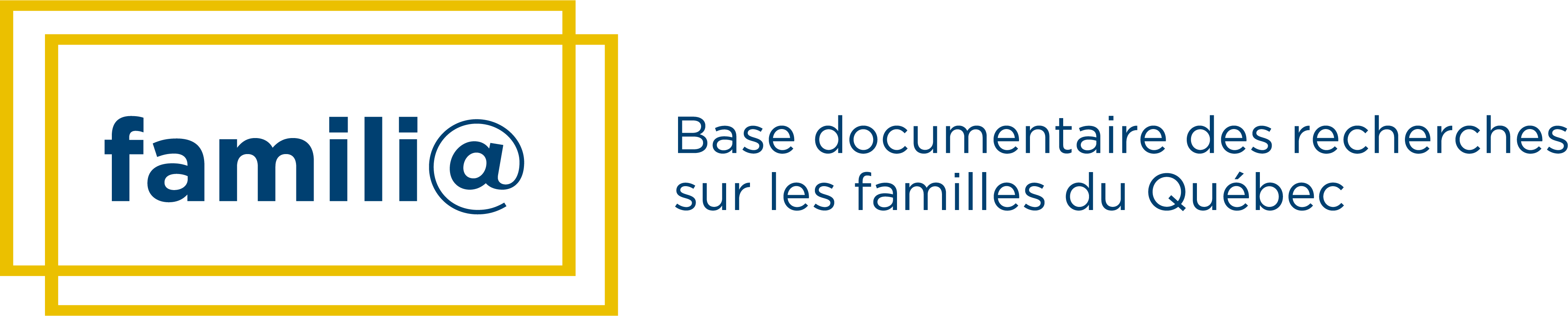En fonction des traditions et des valeurs, l’éducation des enfants varie considérablement d’une culture à l’autre. Alors que certaines privilégient un encadrement strict et des horaires rigides, d’autres, comme celle de la communauté innue d’Uashat mak Mani-utenam, mettent de l’avant des pratiques éducatives valorisant le respect du rythme, la liberté et l’autonomie des enfants. Toutefois, ces méthodes peuvent susciter des incompréhensions et des préjugés de la part de personnes extérieures à la culture. Par exemple, la protection de la jeunesse peut parfois interpréter la liberté accordée aux enfants comme un manque de structure ou un signe de négligence. Pourtant, ces pratiques ne relèvent pas d’un désengagement parental, mais plutôt d’une façon d’éduquer qui s’inscrit dans une logique culturelle différente, où l’on cherche à encourager l’autonomie de l’enfant.
Une équipe de recherche de l’Université du Québec en Outaouais et de l’Université Laval donne la parole à des parents et des grands-parents, membres de la communauté innue d’Uashat mak Mani-utenam, située sur la Côte-Nord du Québec. À travers 15 récits de vie ainsi qu’une dizaine de témoignages tirés de trois recherches antérieures menées au sein de cette même communauté, elle propose une analyse approfondie des pratiques éducatives et des modes de protection des enfants innus. S’attarder à ces récits, c’est découvrir que les pratiques éducatives innues sont riches de sens et contribuent à préparer les enfants à devenir des adultes responsables et confiants.
Le territoire, véritable école vivante
Pour de nombreuses communautés autochtones, le territoire est bien plus qu’un simple espace géographique. Il constitue un véritable lieu d’apprentissage, qui définit l’identité et façonne le mode de vie de chaque communauté. Observer la nature, apprendre à chasser et à pêcher, à reconnaître les plantes, mais aussi à comprendre leur histoire et à préserver leur patrimoine culturel : tout cela enseigne des leçons essentielles sur le respect, l’entraide, la patience, l’interdépendance et le sens des responsabilités. Ces apprentissages – ancrés dans l’expérience et la pratique – sont considérés aussi importants que ceux acquis dans un contexte scolaire. Pourquoi? Parce qu’ils influencent la façon de prendre des décisions, de résoudre des problèmes et de soutenir l’éducation des enfants. Chez les Innu·e·s, par exemple, se retrouver sur le territoire est une activité précieuse, et ce, particulièrement en famille. Il s’agit de moments privilégiés où chacun·e peut se recentrer sur l’essentiel, loin des distractions du quotidien. En pleine nature, les échanges deviennent plus profonds et sincères, permettant aux parents de transmettre aux enfants des connaissances importantes, que ce soit sur leur culture, leur langue ou leurs traditions spirituelles. Une telle immersion se présente alors comme une opportunité d’acquérir des compétences, mais aussi de renforcer la cohésion familiale et le sentiment d’appartenance à la communauté.
L’observation sans pression : une leçon innue
Dans la culture innue, l’éducation des enfants repose principalement sur l’observation des adultes et l’imitation de leurs gestes. C’est pourquoi ces derniers n’imposent pas une manière de faire, mais montrent les gestes à reproduire. L’idée n’est pas d’expliquer un savoir, mais de guider l’enfant pour qu’il découvre par lui-même ce qui fonctionne. Ainsi, au lieu de corriger un enfant qui a du mal à lacer ses chaussures, les parents le laissent expérimenter et comprendre ses erreurs. Se tromper devient alors une occasion de progresser plutôt qu’un échec à éviter. Les enfants prennent ainsi confiance en leurs capacités et apprennent à prendre des décisions et résoudre des problèmes par eux-mêmes. Au fil des expériences de la vie, cette pratique éducative favorise leur autonomie et leur sens de la débrouillardise.
Laisser grandir à leur propre rythme
Sommeil, alimentation, apprentissage : les adultes encouragent les jeunes à développer une compréhension intime de leurs besoins. Entre autres, on les laisse manger quand ils ont faim, plutôt que de leur imposer des repas à des heures fixes. Cette habitude vient en partie du passé douloureux des pensionnats autochtones, où les enfants étaient forcés de manger à des horaires imposés, parfois jusqu’à en être malades. Le retour à l’écoute du rythme naturel permet notamment de restaurer un rapport sain à la nourriture et au bien-être. De même, les enfants sont encouragés à faire leurs propres choix et à prendre leurs propres décisions, dans la mesure du possible. Peu importe leur âge, ils sont en mesure de savoir ce qui est bon pour eux et ont le droit d’être entendus. Ce respect mutuel favorise des relations positives et évite toute forme de contrainte inutile pour l’enfant.
« Quand il dort, je veux qu’il dorme aussi longtemps qu’il le désire. Je ne veux pas être obligée de le réveiller, je veux qu’il vive à son rythme […]. Depuis que j’ai un enfant, mes priorités ont complètement changé, pas seulement en ce qui concerne le travail. Mon rythme de vie a changé parce que je me suis adaptée au sien. » – Kateri, une personne innue
L’art d’accompagner sans entraver
La liberté occupe également une place importante dans l’éducation des enfants innus. Elle repose sur l’idée qu’un enfant doit pouvoir bouger librement pour grandir en santé et acquérir les connaissances nécessaires à la vie quotidienne. Une illustration concrète? La possibilité de circuler librement au sein de la communauté, ce qui permet d’explorer l’environnement et de développer simultanément des compétences physiques et intellectuelles. Cette liberté s’accompagne toutefois de règles et d’un cadre structurant, plus souple que dans d’autres modèles éducatifs.
« Si un enfant se promène en plein milieu de la rue, c’est la voiture qui va se tasser, ce n’est pas l’enfant. Tandis qu’en ville, c’est l’enfant qui doit se tasser. » – Famille d’accueil innue
D’ailleurs, la discipline innue repose sur le respect et la bienveillance : plutôt que d’imposer des règles strictes ou de punir, les parents privilégient l’humour, la taquinerie ou le détournement d’attention pour influencer les comportements. Développer l’humour est encouragé, tandis que se moquer ou manquer de considération envers les autres est peu apprécié.
Les interdictions directes sont rares, sauf en cas de danger. Les parents et grands-parents expliquent clairement pourquoi une consigne existe et quelles sont les conséquences de ne pas la respecter. Les enfants peuvent exprimer leurs opinions et émotions, sans que toutes leurs demandes soient nécessairement acceptées. Ainsi, la transmission des règles se maintient dans un climat de confiance et de dialogue entre parents et enfants.
Réconcilier les visions pour un avenir respectueux
Les pratiques éducatives innues, loin de se limiter à un modèle rigide, montrent la richesse et la profondeur d’une relation unique entre l’enfant, les parents, la nature et la communauté. Toutefois, ce modèle d’éducation est souvent interprété sous l’angle d’une perspective occidentale qui privilégie des repères et normes rigides. À l’image de la Direction de la protection de la jeunesse, pour qui les notions de liberté et d’autonomisation peuvent être vues comme un manque de supervision, une telle vision peut engendrer des malentendus aux conséquences potentiellement dévastatrices pour les familles autochtones. Plutôt que de poursuivre dans une logique de jugement fondée sur l’incompréhension mutuelle, une ouverture se présente : celle d’une rencontre entre deux visions de l’éducation. D’un côté, une approche autochtone où l’apprentissage s’ancre dans l’expérience, l’observation et le respect du rythme naturel de l’enfant ; de l’autre, une approche occidentale souvent centrée sur la structure, le contrôle et la conformité à des normes prédéfinies. Repenser les modèles d’intervention, inviter à se défaire de ses préjugés et à comprendre que, parfois, la liberté laissée à l’enfant ne cache pas une négligence, mais bien un profond respect de son rythme et de sa culture, appert alors primordial. L’avenir pourrait alors se dessiner dans une collaboration plus éclairée, dans laquelle les différentes façons d’éduquer se complètent et se respectent.