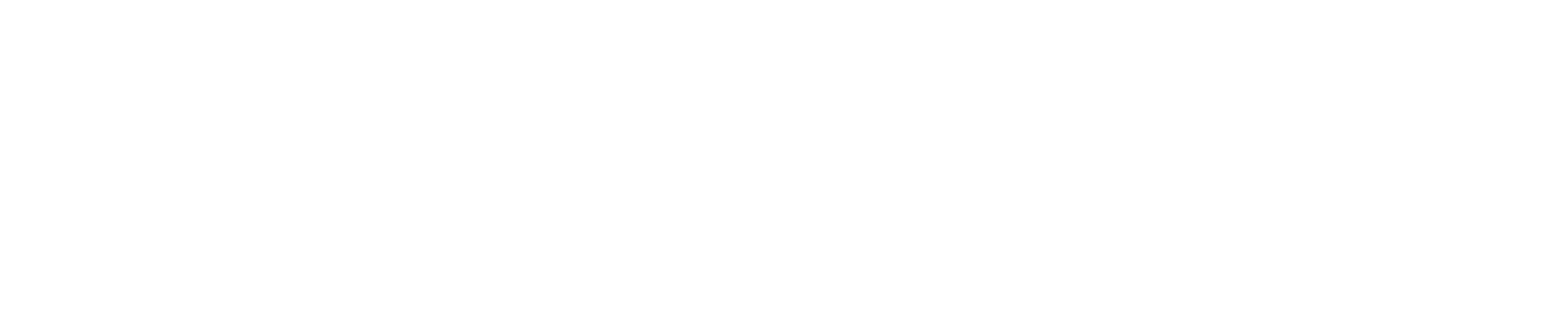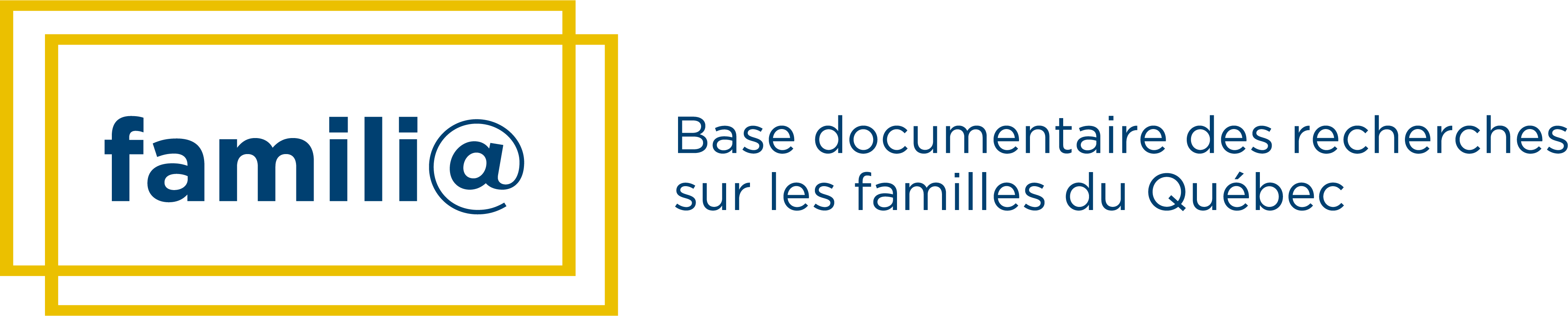Dans une petite chambre aux couleurs pastel, Soumaia, immigrante de première génération, regarde avec tendresse son mari bercer leur enfant. Leur fille, née au Québec, incarne la deuxième génération d’une famille arrivée il y a déjà plus d’une décennie sur le sol canadien, réputé pour son système de santé et de services sociaux accessible. Pourtant, malgré l’instant joyeux, la nouvelle maman se demande ce qui marquera l’expérience périnatale de sa fille si elle devient mère à son tour. Elle se remémore son propre vécu et celui de son mari, et les défis qui se sont présentés sur leur chemin durant sa grossesse. Elle se souvient bien des menaces de congédiement de son employeur suivant l’annonce de son projet familial et du sentiment d’être jugée par certain·e·s professionnel·le·s de la santé.
Une étude récente s’intéresse à l‘expérience des parents issus de l’immigration, plus à risque de vivre de la détresse psychologique en période périnatale. Comment se dessine leur parcours entourant la naissance? Quels facteurs favorisent une expérience positive et lesquels, au contraire, la fragilisent? Surtout que peut-on apprendre pour mieux les soutenir lors de cette période haute en émotions?
Pour répondre à ces questions, une équipe de recherche de l’Université McGill, de l’Université du Québec en Outaouais, de l’Université du Québec à Montréal et de l’Université Laval recueille les témoignages de 16 femmes et 10 hommes hétérosexuel·le·s, originaires d’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient, de l’Asie et de l’Afrique et ayant mis au monde un enfant 6 mois plus tôt. Immigrant·e·s de première et deuxième génération, toutes et tous ont vécu une détresse psychologique durant la période périnatale.
Être parents entre deux mondes
Même projet, même aventure? Pas vraiment. Quand les personnes immigrantes de première et seconde génération deviennent parents, on pourrait croire qu’elles vivent la même expérience. Bien qu’elle confirme en partie ce point, l’étude relève tout de même un écart. En effet, celles de première génération font état d’un stress culturel plus important, d’une plus grande discrimination et rencontrent plus de difficultés à naviguer dans le système de santé. Pourquoi cette différence? L’équipe de recherche suggère que la vulnérabilité liée à leur migration récente et aux pressions culturelles qui en découlent pourrait en être responsable.
C’est un fait : pour les personnes immigrantes, les chocs interculturels présentent des défis de taille quand vient le temps de devenir parents. Une véritable dualité se dessine entre le respect des traditions du pays d’origine et l’adoption des pratiques du pays d’accueil. D’un côté, la famille insiste pour que les jeunes parents perpétuent certaines façons de faire. De l’autre, la société d’accueil encourage — et parfois impose — l’adoption de ses propres normes, notamment en matière de santé. Une mère immigrante de première génération originaire du Sénégal a, par exemple, raconté que les examens médicaux constants pendant les soins de maternité — notamment les tests sanguins — lui avaient causé de la détresse. Un père, lui aussi immigrant de première génération, souhaitait conserver une tradition culturelle de son milieu natal, mais s’est vu contraint d’y renoncer en raison des directives sanitaires en vigueur au Québec.
Les femmes rapportent également être aux prises avec de nouvelles attentes culturelles irréalistes de la part de la société québécoise. D’un côté, elles doivent demeurer les personnes qu’elles étaient avant l’arrivée de l’enfant, notamment en continuant à faire du sport et à entretenir leurs intérêts intellectuels. D’un autre, elles doivent jongler avec des attentes démesurées face à la maternité :
« C’est comme si elles devaient toujours être parfaites dans tout et devraient faire comme dans les publicités : utiliser des couches lavables, pratiquer une éducation positive, diversifier l’alimentation de l’enfant en suivant ses envies, allaiter et tout le reste. » [Traduction libre]
— Un père
Quand les inégalités s’invitent en périnatalité
Mais ce n’est pas tout. Si pour certains parents, l’accès à l’accompagnement périnatal est un jeu d’enfant, pour d’autres, il s’apparente à un véritable parcours du combattant. C’est notamment le cas pour les parents immigrants de première génération, qui en plus de devoir affronter les barrières culturelles, doivent composer avec des difficultés propres au réseau de la santé et des services sociaux.
« Donc, il faut supplier pour tout, n’est-ce pas? Il faut connaître les bonnes personnes pour obtenir les services dont on a besoin, c’est ça? Et pour un immigrant, c’est encore plus difficile, non? Parce qu’on n’a pas de liens ici, pas d’historique. » [Traduction libre]
— Un père
Les barrières linguistiques inquiètent aussi certaines personnes immigrantes, qui craignent d’avoir de la difficulté à être comprises dans des situations d’urgence, durant l’accouchement par exemple.
Les discriminations vécues et perçues viennent compléter le portrait. Qu’elles soient liées à l’apparence physique, au genre, à l’origine ethnoculturelle — qu’elles aient lieu en milieux de travail ou de la santé — celles-ci sont bien présentes et nuisent à la santé mentale des nouveaux parents. Plusieurs femmes se sentent jugées en regard de leur apparence ou de leur maternité, voire sont discriminées et harcelées au travail concernant leur congé parental ou leur projet familial. Leur douleur est parfois minimisée par certain·e·s professionnel·le·s de la santé, qui semblent prioriser les soins prodigués envers les personnes blanches après l’accouchement. D’autres encore développent des doutes envers leurs propres compétences parentales après des rencontres déplaisantes avec le personnel de la santé.
« Je doutais énormément de ce que j’observais chez l’enfant et les commentaires des professionnel·le·s de la santé y contribuaient. Même s’il s’agit d’une chose insignifiante, je commence à être stressée (…) C’était au point où ça a affecté toutes mes sensations, ma perception de moi-même en tant que personne, de mon fonctionnement, de ma capacité à me fier à mes connaissances et à mon jugement. » [Traduction libre]
— Une mère
Être papa immigrant, un casse-tête identitaire
Les parents doutent de leurs capacités à un moment ou un autre, c’est un fait. Mais l’étude révèle des défis spécifiques aux pères. En effet, les papas participants, tant ceux de première que de seconde génération, ont confié faire face à plusieurs obstacles, notamment : inégalités entre les hommes et les femmes dans les droits et les rôles parentaux, manque de ressources dédiées aux pères, dévalorisation de leurs besoins par des professionnel·le·s de la santé et jugement envers la durée de leur congé parental, parfois jugé trop long par des collègues de travail.
Or, ces entraves au bien-être psychologique des pères en contexte périnatal ne se limitent pas à la société d’accueil. Pour nombre d’entre eux, les normes culturelles transmises et encouragées par la famille élargie jouent aussi un rôle important. Certains proches encouragent les pères à travailler plus, à prendre de moins longs congés parentaux et à conserver une forme de masculinité traditionnelle, peu compatible avec un engagement actif dans la sphère familiale et émotionnelle. Or, le tout impacte négativement le noyau familial. Les mères immigrantes de première génération rapportent se sentir plus seules, en manque d’un soutien social habituellement prodigué par la famille élargie demeurée au pays d’origine. Pour les pères de première génération, se conformer aux nouveaux rôles de la société d’accueil représente parfois un facteur de stress et de dépression important.
Parentalité immigrante : quand la culture d’accueil peut changer la donne
Face à cette réalité, existe-t-il des éléments qui aident les parents immigrants durant la période périnatale? L’étude révèle que oui! Les femmes immigrantes apprécient souvent le style parental valorisé au pays d’accueil, qui repose moins sur la hiérarchie entre parents et enfants, contrairement à celui plus autoritaire de leur pays d’origine. Le respect des limites personnelles facilite aussi leur expérience. Les parents auraient ainsi plus de liberté dans le choix du modèle parental qu’ils souhaitent incarner alors que dans leur pays d’origine, les conseils non sollicités peuvent être fréquents et intrusifs.
Du côté des pères, certains se disent heureux d’avoir pu prendre un plus long congé parental, ce qui aurait été difficile dans leur pays d’origine. Une répartition plus équitable du travail domestique est aussi perçue comme un aspect positif par les parents immigrants de seconde génération. Les pères ont ainsi la possibilité de prendre une plus grande part des responsabilités quotidiennes et ainsi d’alléger la charge mentale des mères.
Finalement, le système de santé québécois — plus accessible — ainsi que les politiques publiques québécoises favorables — comme les longs congés parentaux — seraient des atouts de taille dans l’expérience périnatale des parents immigrants. L’accompagnement lié au bébé, le soutien à la santé mentale des parents, l’accès aux bénéfices sociaux (comme les rendez-vous médicaux gratuits et en ligne) favorisent une bonne santé psychologique.
Pour que périnatalité ne rime plus avec inégalité
Dans l’optique de mieux soutenir les parents immigrants durant la période périnatale, plusieurs solutions sont mises de l’avant par l’équipe de recherche. Face à la discrimination, développer des interventions sensibles aux différentes réalités culturelles des parents immigrants serait une voie à suivre. La lutte contre la discrimination passe aussi par la formation des professionnel·le·s de la santé et des services sociaux à reconnaître leurs biais et à adapter leurs pratiques de manière inclusive. Informer les personnes immigrantes de leurs droits — au travail et dans les soins — leur permettrait également de mieux faire face aux injustices. Concernant les plus grandes vulnérabilités des premières générations, l’accent doit être mis sur la connaissance des ressources existantes. Cela peut être fait notamment en intégrant dans les ressources dédiées aux personnes nouvellement arrivées des informations sur les services sociaux et de santé.
Finalement, les interventions pourraient être adaptées en fonction du genre. Les mères, souvent confrontées à des tensions culturelles liées à la famille, bénéficieraient davantage d’interventions ciblant le support familial. À cet effet, des groupes de soutien à la grossesse ancrés dans une approche culturellement sécuritaire peuvent être envisagés. Quant aux pères, qui semblent vivre des difficultés principalement au travail, ils pourraient profiter d’interventions et de ressources qui ciblent l’espace professionnel.
L’espoir demeure donc pour Soumaia : si les solutions proposées sont mises en place, sa fille pourrait, si elle devient mère un jour, vivre une expérience périnatale plus sereine et mieux accompagnée dès ses premiers pas vers la parentalité.