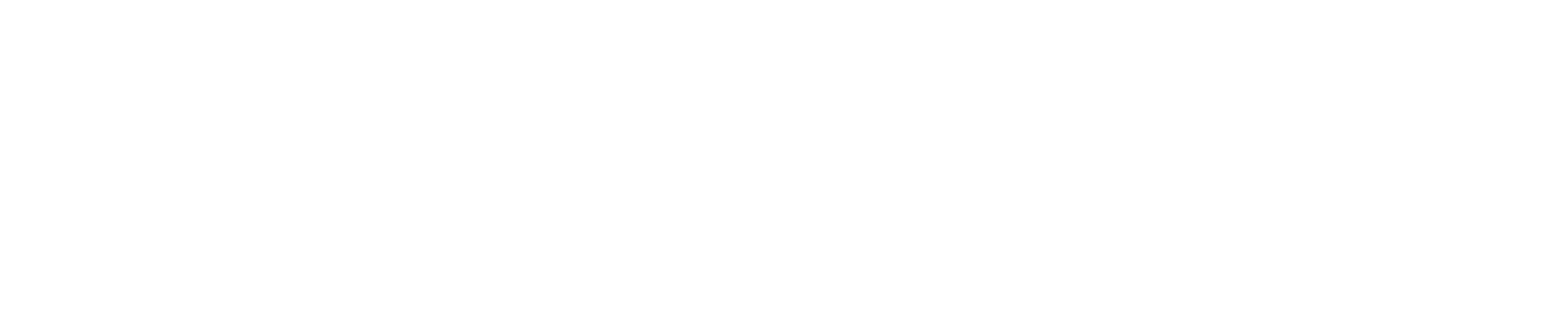Les « mauvaises mères », qu’elles soient négligentes ou surprotectrices, causeraient la schizophrénie ou l’autisme de leur enfant. Pardon? Oui, il y a quelques décennies, les théories psychiatriques dominantes blâmaient les mères. Certes, la médecine a évolué. Mais la question se pose tout de même : avec le développement des neurosciences et de la psychologie, accuse-t-on toujours les mères d’être responsables des troubles mentaux de leurs enfants? La culpabilisation demeure bel et bien, mais prend une nouvelle forme!
C’est la conclusion que tirent Isabelle Courcy et Catherine des Rivières-Pigeons, professeures de sociologie à l’Université du Québec à Montréal, de leur étude sur le sentiment de culpabilité des mères ayant un enfant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Afin de mieux comprendre ce sentiment, les chercheuses mènent des entrevues auprès de 13 femmes ayant un enfant avec un TSA. L’étude fait partie d’une recherche de plus grande envergure sur l’implication des mères dans un programme d’intervention intensive précoce pour les jeunes ayant un TSA.
De la cause au remède : la mère aujourd’hui thérapeute
Autrefois perçues comme les responsables de l’autisme de leur enfant, les mères sont aujourd’hui vues comme les responsables de son progrès. Des années 1940 jusqu’aux années 1990, le discours scientifique-médical décrit l’autisme comme un repli sur soi de l’enfant qui serait causé par un manque d’affection de sa mère. Depuis, les avancées médicales ont rectifié le tir : l’autisme est une maladie neurologique avec une composante génétique. Le lien avec la personnalité de la mère ou son style parental est simplement inexistant.
Les femmes ne sont donc plus pointées du doigt? Pas si vite! Les professionnels de la santé voient aujourd’hui les parents, mais surtout les mères, comme les thérapeutes de leur enfant. En effet, l’implication des parents dans les programmes d’intervention pour les enfants avec un TSA est fortement recommandée par les programmes de réhabilitation et appuyée par la recherche scientifique. Mais ce sont surtout les mères qui s’y investissent et elles sont, plus que jamais, encouragées à le faire. Elles portent sur leurs épaules le poids de tout faire pour favoriser le développement de l’enfant. Résultat? Un sentiment de culpabilité à l’idée de ne pas être en mesure d’être la meilleure thérapeute possible.
« Nous supposons que l’évolution des attentes envers les mères qui s’occupent de jeunes enfants atteints de TSA illustre clairement le passage d’une vision des mères comme cause, à celle des mères responsables du bon développement, ce qui donne lieu à de nouvelles formes de culpabilisation des mères. »(traduction libre des propos des auteures)
Une culpabilisation qui prend plusieurs visages : remise en question des habiletés parentales si le diagnostic n’est pas dévoilé ou, à l’inverse, sentiment de ne pas en faire assez lorsque le diagnostic l’est.
Dévoiler ou ne pas dévoiler?
Dévoiler, ou non, le diagnostic? Voilà le premier dilemme qui s’impose aux mères. Dévoiler le diagnostic de TSA, c’est s’assurer de ne pas être vues comme de mauvaises mères qui n’éduquent pas bien leur enfant. En effet, pour les gens qui ignorent le diagnostic, les comportements de l’enfant sont souvent perçus comme le fruit d’habiletés maternelles défaillantes : la mère est trop permissive, trop protectrice, trop stricte. Bref : elle ne serait pas capable de l’éduquer correctement. Faire taire les jugements en révélant le diagnostic, alors? Peut-être, mais attention! L’autisme, encore aujourd’hui, fait peur et peut entraîner discrimination ou stigmatisation envers l’enfant. Par exemple, une mère rapporte qu’il est difficile de trouver une garderie qui voudrait bien accueillir son enfant dès lors que le TSA est mentionné.
« J’ai vraiment eu du mal à trouver une garderie pour Samuel. Dès que je mentionnais le mot « autisme », ils me raccrochaient au nez. » (traduction libre des propos de Mary, l’une des mères interrogées)
Dans certains cas, les mères évitent donc de révéler le diagnostic et préfèrent porter le blâme de la « mauvaise mère » pour éviter que leur enfant ne subisse de la discrimination.
En faire plus, plus, toujours plus
Ne pas avoir détecté le TSA plus tôt, s’investir inutilement ou trop peu : les mères se culpabilisent souvent de ne pas s’impliquer assez suite à l’annonce du diagnostic. C’est que les professionnels de la santé recommandent aux parents de s’investir tôt et de manière très intensive pour améliorer les chances que l’enfant intègre l’école régulière et favoriser son développement. Ça se mesure comment, une implication intensive? Les mères doivent s’y investir entre 20 et 40 heures par semaine! Cette pression est accentuée par l’idée voulant qu’une « bonne » mère, avec son « instinct maternel », doit détecter toute anomalie chez son enfant, en plus d’être extrêmement investie dans son éducation.
Pour les femmes interrogées, la demande est irréaliste et source d’anxiété. Tout d’abord, identifier les signes d’un TSA, plus facile à dire qu’à faire! Surtout s’il s’agit d’un premier enfant. Puis, les heures d’intervention par semaine prescrites ne sont pas compatibles avec un emploi à temps plein. Résultat : la barre est trop haute et leur donne l’impression de ne jamais en faire assez.
« Je comprends les recherches et pourquoi les professionnels disent que moins de vingt heures ce n’est pas optimal. Mais si l’enfant a 18 heures, il en a 18. C’est déjà quelque chose! Ils doivent cesser d’effrayer les parents! Il y a tellement de raisons pour lesquelles nous nous sentons mal. Nous n’avons pas besoin de nous sentir coupables de ne pas être en mesure de faire 40 heures d’intervention par semaine! » (traduction libre des propos de Karen, une des mères interrogées)
Trop… c’est aussi pas assez
Ce n’est pas tout! La culpabilité apparaît aussi lorsque les mères ont moins de temps pour le reste de la fratrie. En effet, impossible de consacrer autant de temps et d’énergie aux autres enfants de la famille. Là encore, le syndrome de la « mauvaise mère » ressurgit.
« Certaines personnes disent que j’aurais peut-être trop fait pour Sebastian et que j’ai négligé mes autres enfants. Certains disent que c’est la raison pour laquelle ma fille est maintenant diagnostiquée avec une dysphasie. Comment pouvons-nous savoir? Mais je n’avais pas le choix. Je devais aider Sebastian à devenir indépendant. »(traduction libre des propos de Lea, une des mères interrogées)
La « mère-intervenante », ou le reflet d’inégalités femmes-hommes
Avoir un enfant avec un TSA n’est pas de tout repos : cela exige des efforts physiques, mentaux et émotifs. Les chercheuses rappellent qu’à cela s’ajoute un flagrant manque de soutien et de services pour les parents. Un manque que les parents, surtout les mères, doivent compenser. Comment cela affecte-t-il les dynamiques familiales? Les mères effectuent la plus grande part du travail invisible de soins et quittent souvent leur emploi, tandis que les pères s’investissent davantage dans leur travail pour contrebalancer la diminution du revenu familial. Ainsi, avoir un enfant avec des besoins particuliers encouragerait la division sexuelle du travail. De plus amples recherches sur la répartition du travail domestique et de soin au sein des familles d’enfants avec un TSA permettrait peut-être de favoriser un partage plus équitable des responsabilités entre les parents.