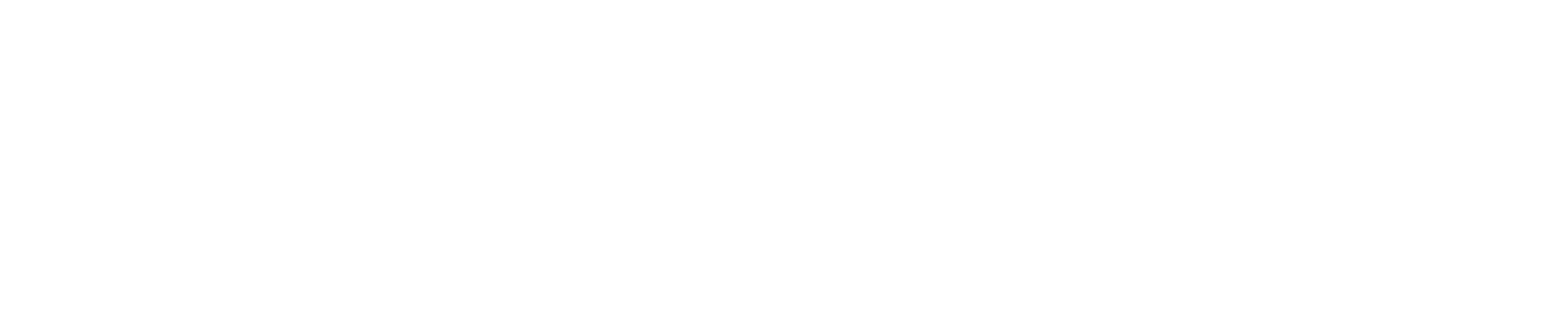Lucia[1], 25 ans, est arrivée au Québec comme travailleuse temporaire fin 2010. Son visa de travail expire alors qu’elle est enceinte de son premier enfant. Victime de violence conjugale, elle se sépare de son conjoint, malgré les menaces de dénonciation et de déportation de la part de sa belle-famille. Vivant dans la peur, elle ne reçoit aucun soin durant sa grossesse. Elle n’a ni carte d’assurance maladie ni argent et elle finit par accoucher seule chez elle. Elle sera finalement transportée d’urgence à l’hôpital après qu’un voisin ait appelé le 911.
La situation de Lucia paraît extrême et exceptionnelle. Pourtant, elle n’est pas la seule à devoir affronter de tels défis. Les femmes enceintes sans-papiers peuvent avoir de grandes difficultés à accéder aux soins de santé et à un réseau de soutien et d’information. La recherche se penche sur cette situation particulière, très peu documentée, pour mettre en lumière les expériences de ces femmes « invisibles ».
Entre 2010 et 2012, les chercheuses se sont entretenues avec 18 femmes, dont la situation est aujourd’hui régularisée. Elles les ont rencontrées grâce à l’intermédiaire d’intervenants en service social et de professionnels de la santé. Ces femmes ont entre 25 et 40 ans, sont arrivées au Canada il y a plus de cinq ans, et leur situation d’illégalité a duré entre une et quinze années.
Anxiété, peur et isolement
Anxiété, peur et isolement sont sans doute les mots qui résument le mieux l’expérience d’une grossesse dans ces conditions, d’après la majorité des femmes rencontrées.
« Le stress durant toute ma grossesse a été tellement… trop, que je n’ai pas pu profiter de ma grossesse. […] Au début, durant les cinq premiers mois, je crois que j’ai plus pleuré que je n’ai jamais pleuré de toute ma vie… »
Elles sont préoccupées par le risque de déportation ou même la possibilité d’être séparées de leur enfant si celui-ci obtient le droit de demeurer au pays. La plupart n’avouent leur situation de sans-papiers à personne, à l’exception d’une ou deux amies proches :
« Lorsque vous n’avez pas de statut, vous vous sentez comme si tout le monde était après vous […] J’avais toujours peur que si je m’approchais d’une agence [de la santé], je sois signalée à l’immigration, d’un coup de téléphone. »
Elles doivent souvent travailler durant toute leur grossesse, dans des conditions précaires :
« La nuit avant d’accoucher, je travaillais encore. Je savais que le travail avait déjà commencé, mais je suis allée à l’hôpital seulement quand j’ai perdu les eaux […] Pendant ce temps, je travaillais quatorze heures par jour parce que je cherchais à économiser de l’argent pour [les frais d’accouchement à] l’hôpital. »
Payer pour accoucher
Certaines des participantes n’ont eu aucun examen médical avant leur accouchement. Même lorsqu’elles se décident enfin à passer la porte des établissements de santé, elles se voient parfois refuser l’accès aux soins:
« Il s’agit d’une situation terrifiante. Ça vous prive de votre dignité […] Après avoir essayé une fois [de demander des soins], vous ne voulez pas essayer de nouveau. Vous ne voulez pas passer par la même expérience de nouveau avec d’autres organismes. Alors, vous cessez d’essayer. »
Doris, dont la demande de statut de réfugiée a été rejetée, perd sa couverture médicale alors qu’elle est enceinte de son troisième enfant. Quand l’hôpital lui demande de payer plusieurs milliers de dollars après son accouchement, qui s’est déroulé sans complications, elle n’a pas de quoi acquitter la facture. L’hôpital interdit au père de voir l’enfant et refuse d’émettre l’acte de naissance avant que la totalité des frais liés à l’accouchement soit payée.
Plusieurs participantes disent avoir quitté l’hôpital dans l’heure suivant l’accouchement, puisqu’elles n’avaient pas les moyens de payer les frais d’une nuit ou d’une journée supplémentaire.
« Après l’accouchement, je suis allée aux toilettes et puis je suis partie… […] L’une des infirmières est venue et elle a dit : « Vous savez, si vous passez la nuit ici vous devez payer 1500 $ » […] Ouais, le même jour je l’ai eu [mon bébé], je rentrais chez moi et il y avait une tempête de neige. Je ne pourrai pas oublier cette nuit, il y avait une grosse tempête de neige… et je suis rentrée avec le bébé. Parce que je ne pouvais pas rester une autre journée à l’hôpital pour payer un autre 1500 $. »
Malgré ces expériences difficiles, certaines femmes ont eu plus de chance. Leur rencontre avec des intervenants sensibles à leur situation a permis de briser le cercle d’isolement et de peur.
« Mon expérience n’a pas été négative, mais je connais beaucoup de monde qui n’a pas été aussi chanceux que moi, tu comprends, et qui n’a pas eu ce type d’aide. Certaines d’entre nous ne parleraient pas du tout, tu comprends, elles ne diraient rien de leur situation, et seraient en souffrance. Pour moi, ça a été OK. C’était bien, j’avais mon docteur. Mais si je n’avais pas eu mon docteur, ce docteur, les choses se seraient passées de façon différente… »
Don’t ask, don’t tell
Au vu des témoignages, il paraît essentiel que ces femmes puissent avoir confiance dans les institutions. Une politique de confidentialité – « don’t ask, don’t tell » – permettrait de rassurer les familles, qui pourraient recevoir des soins dans un environnement perçu comme sécuritaire.
D’après les auteures, les soins de santé devraient d’ailleurs être gratuits et accessibles à tous et à toutes. L’association Médecins du monde, par exemple, a ouvert une clinique fondée sur le bénévolat à Montréal. Mais elle est loin de pouvoir répondre à l’ampleur de la demande.
Ces femmes ont fui des violences dans leur pays d’origine ou ont migré pour offrir un avenir meilleur à leur famille. Elles vivent avec leurs enfants à Montréal, travaillent et contribuent à leur communauté. Pourtant, elles demeurent prisonnières d’un statut instable et sont vulnérables aux abus. Plusieurs d’entre elles disent que si elles rencontraient une autre femme enceinte et sans-papiers, elles lui conseilleraient de vaincre sa peur et de demander de l’aide. Les chercheuses appellent la société québécoise à vaincre sa peur elle aussi. L’objectif : respecter la dignité de chacun et le droit humain fondamental qu’est l’accès aux soins de santé.
[1] Les noms des femmes qui ont participé à l’enquête ont été changés pour préserver leur anonymat.